Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron
Page 1 sur 1
 Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron
Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron
Exemple de vie de chrétiens exemplaires
Source : Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme siècle - A. PELLISSIER - Professeur de l’Université - Honoré d‘un prix Montyon par l'Académie Française en 1885
( Extraits)
1 - LE COLONEL PAQUERON – UN EXEMPLE DE VIE CHRÉTIENNE
2 - FRÉDÉRIC OZANAM – PROFESSEUR ET FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL QUI LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
PRÉFACE
Ce livre est le nobiliaire de la France chrétienne. Il s’adresse à tous les gens de bonne volonté. Les lecteurs de bonne foi y trouveront dans le détail, des faits historiques et des vérités morales de premier ordre ; ils y trouveront dans l’ensemble, la solution d’un problème capital, le problème de notre avenir.
Quand parfois il a le bonheur d’échapper au tourbillon de la vie au jour le jour, tout Français se pose cette redoutable question: « Où allons—nous? Vers quel avenir la France est-elle entraînée? Pourquoi nos pères et nos aïeux ont-ils été meilleurs et plus grands que nous? » Au nom de l’histoire et de la raison, ce livre vient répondre: « Parce qu’ils ont été plus chrétiens »; et cette réponse vaut à la fois et pour la glorification de nos pères et pour l'éducation de nos enfants; car Dieu a fait les nations guérissables.
A cet effet, rien de plus efficace que le récit des beaux exemples. Les faits sont des témoins qu’on ne peut récuser ; et si ces témoins proclament que le sentiment religieux développe, exalte et féconde les penchants supérieurs de la nature, que le christianisme et le plus puissant auxiliaire du patriotisme, du dévouement, du courage militaire et de la Charité; ne concevra-t-on pas que c’est le plus révoltant mensonge que de présenter le Christ comme l’ennemi de la civilisation ?
Or, c’est l‘esprit chrétien qui produit pour l’honneur de la France des soldats comme Paqueron et La Moricière, des marins comme Marceau et Courbet, des politiques comme Montalembert, des professeurs comme Ozanam, des administrateurs comme Cochin, des commerçants comme Chardon-Lagache, des artistes comme Hippolyte Flandrin.
Ces études sont pures de tout esprit de parti politique, parce que la vérité, la religion et la France sont au-dessus de toute espèce de forme de gouvernement. L’un des mensonges les plus criminels de certains sectaires est de soutenir que l’Église est l’ennemie de la République et que la religion est hostile à la démocratie: l’Église et la religion ne sont ni monarchistes ni républicaines : elles veulent le règne de Dieu sur la terre, elles sont pour la justice, pour l’ordre, pour la liberté; mais par cela même, elles sont contre l’esprit révolutionnaire.
Oui, au nom de la vie et de la mort, nos enfants ont à choisir entre le Christ et la Révolution, entre l’Évangile, qui est le code de la liberté, et la Déclaration des droits de l’homme, vide et dangereux programme de l’anarchie et du despotisme de la franc-maçonnerie.
Il y a deux manières de persuader : l’une insinuante et plus sûre, convient au service des intérêts humains; elle ménage et prépare le succès par des détours qui ne permettent pas au lecteur de voir où on le conduit; l’autre, plus périlleuse, attaque le mal en face et proclame loyalement son but. Je dois avouer que c’est la seconde méthode que je préfère et que j’ai toujours employée. Notre génération n’a pas besoin d’être encouragée dans sa suffisance et son inertie; elle a plus à profiter d’un bon conseil que d’une adulation banale.
Sans les traiter en ennemis, je suis obligé de condamner les tièdes; ceux qui croient que tout s’arrangera, que nous traversons une crise, que le démon (l`ange déchu) n’est pas aussi mauvais qu’il est noir, que la bonne manière de faire le bien, c’est de le faire en douceur... Dès longtemps La Fontaine leur a répondu :
La paix est fort bonne de soi,
J'en conviens; mais de quoi sert—elle
Avec des ennemis sans foi.
Profonde observation morale, d’où la conclusion : «Il faut faire aux méchants guerre continuelle»

Jean de la Fontaine - Les Fables (1621 à 1695)
« C’est une fausse piété, disait encore Pascal, de conserver la paix au prix de la vérité.»

Blaise Pascal - Pensées - (1623 à 1662)
La pire chose du monde, c’est d’avoir un avocat peureux ou tiède : par de tels défenseurs les procès s’éternisent. Dieu nous préserve aussi d’un certain genre tout nouveau d’optimisme : théorie des épicuriens vulgaires qui nous disent avec une résignation cynique : « Oui, c’est convenu; nous sommes en pleine décadence; mais laissez-nous... mourir en paix. » Non, mille fois non. Le vrai serviteur de la France est comme le médecin qui demeure auprès de son malade, tant qu'il lui reste un souffle de vie et d'espoir. Tout a été dit et bien dit sur les personnages historiques dont je parle : ils appartiennent au domaine de la vie ordinaire; je ne me suis donc fait aucun scrupule d'emprunter les faits aux écrivains qui les ont racontés.
Les historiens qui m’ont servi de guides sont tous animés du désir sincère de servir comme moi la cause de la France et de la religion.
A la fin d’un long et sérieux exercice de l’éducation publique et privée, comme fruit d’un travail qui n’a pas été sans succès, la conclusion qui m’est imposée par mon expérience, c’est que la doctrine chrétienne doit dominer et inspirer toute l’éducation de la jeunesse française. En bonne conscience, est-il une mère qui veuille souscrire à l’arrêt inhumain du législateur spartiate et jeter au gouffre le corps chétif de son enfant nouveau-né? Eh bien, femmes françaises, l'âme de vos enfants réclame mille fois plus de soins que le corps, soins affectueux, soins assidus, soins éclairés.
Honte et malheur à l’ineptie de nos Lycurgue ( Ancien roi de Sparte) contemporains, qui osent appeler respect de la liberté morale, l’abandon brutal des enfants à tous les entraînements de l’ignorance et de la passion.
Je voudrais au contraire, je voudrais apprendre à nos contemporains le chemin de l’Église, je voudrais ouvrir du moins ce port à nos enfants. Agissant ainsi, j’obéis à ma conscience, je remplis un devoir envers la patrie que je souffre de sentir abaissée dans le monde; devoir envers l'avenir; devoir envers la jeunesse française dont l’éducation a été la tâche de ma vie entière, tâche bénie, qui m’a valu le double honneur d’attirer sur ma tête les foudres municipales et les palmes académiques.
Si ces tableaux historiques éclairent, consolent, encouragent quelques âmes, si l’expérience apprend qu’ils peuvent faire un peu de bien, j’essaierai de continuer cette galerie des gloires chrétiennes de la France.
A ses « ennemis dans le mal triomphants », le chrétien peut dire comme Pascal: « Je suis seul contre trente mille; mais j’ai la vérité, et nous verrons qui l’emportera.»

LE COLONEL PAQUERON
I. Sa jeunesse. — Il. Ses premiers malheurs. —- 111. Son journal.
IV. Sa vocation religieuse. — V. Ses œuvres.
1- LA JEUNESSE DE PAQUERON
Voltaire voulait bien maintenir la religion comme la police à titre d’instrument social et politique; Rousseau comptait sur la raison naturelle et le sentiment pour assurer le parfait bonheur de l’humanité; Voltaire et Rousseau sont aujourd’hui détrônés par les athées anarchistes qui, réduisant la vie humaine à une suite de jouissances sans frein ni loi, ne veulent ni maître, ni Dieu.
A l'heure présente, l’opinion publique s’agite dans l’anxiété. Pourquoi ne prend-elle pas résolument le parti de s’engager dans la seule voie qui conduit au saint?
C’est qu'au milieu du chaos des sophismes, quelques esprits mal informés continuent à soutenir de bonne foi que la discipline catholique, supportable aux temps de croyance comme le moyen-âge, n’est plus tolérable à nos temps de science et de liberté, que les étroites pratiques de la religion répugnent aux esprits larges et ouverts, et que la raison émancipée rejette le joug de la foi.
Eh bien! s’il faut un témoignage simple et irrécusable à ces cœurs irrésolus, voici un homme d’un coeur ardent et d’un esprit très vif, qui a traversé dans sa jeunesse la société la plus dissolue de Paris, un homme qui a subi l'enseignement d’une école où l’irréligion était à l’ordre du jour, qui a suivi avec éclat la carrière militaire, qui a cultivé les sciences physiques et chimiques pour en tirer les plus ingénieuses applications, un homme qui, par un travail de soixante années, a mérité tous les honneurs que la vanité humaine peut décerner; et cet homme a été en même temps le catholique le plus fervent et le plus scrupuleux, cet homme n’a jamais négligé une seule des pratiques dont notre tiédeur et notre ignorance sont effrayées.
Rien ne prouve mieux combien la fidélité absolue au dogme et au culte catholique est en harmonie parfaite avec l’étude, avec la science, avec le progrès. Voilà l'enseignement qui ressort de la vie de ce soldat qui, pendant plus de soixante ans, a pris pour devise et pour règle de conduite: « Tout par Dieu et pour Dieu. Dieu est ma force, mon soutien et mon espoir. »
C’est donc le propre de la vertu chrétienne, d’avoir créé et mis dans le monde un genre d’hommes auxquels l’Église donne parfois le nom de saints, comme Louis IX, Thomas d’Aquin, François-Xavier ou Vincent de Paul.
L’histoire n’a pas trouvé de titres pour eux ; il serait juste de les appeler les grands hommes de bien. Tandis que la plupart des hommes mettent leurs aptitudes au service de leur fortune ou de leur gloire, ces vrais chrétiens dépensent la même fécondité d’esprit, la même puissance de caractère au service de leur pays et de leur prochain: hommes véritablement supérieurs, puisqu'ils ne demandent rien au monde et attendent de Dieu seul le prix de leur héroïsme modeste.
A côté, disons mieux, au-dessus des grands hommes de guerre, des grands hommes politiques, des grands hommes de lettres, la justice et la religion portent au premier rang les grands hommes de bien. Nicolas Paqueron naquit à Ancerville, en Lorraine, le 5 décembre 1791, dans une famille chrétienne dont la fortune avait été gravement compromise par les troubles qui agitaient la France entière depuis plus de deux ans.
Son âme fut donc trempée dès l’abord à la triple source de la foi, du travail et de la pauvreté.
Sur les instances bienveillantes d’un oncle maternel, qui était capitaine d'artillerie, en 1801, l’enfant fut envoyé à Paris pour se préparer à la carrière militaire en dirigeant ses études vers l’École polytechnique. Avec une ardeur et une assiduité que le succès vint récompenser, en moins de sept ans il eut achevé le cours de ses études préparatoires, et à la fin de l’année 1808, il entrait le vingt-quatrième à l’École polytechnique.
Mais son premier succès fut attristé par sa première douleur ; à la fin de l’année 1809, une mort presque soudaine enleva au jeune homme son protecteur et son guide, cet oncle dont l’exemple, les conseils et l'appui devaient l'accompagner et le soutenir. Cette perte lui fit au cœur une blessure qui ne se ferma jamais. Pour cette jeune âme de dix-sept ans, le mal de l’abandon était aggravé par la corruption morale du temps. Enivrée de gloire militaire, la société française, en 1809, n'avait d’autre dieu que le plaisir, et d’autres conseillers que des épicuriens éhontés. Quand la corruption est dans l’esprit public, les consciences individuelles sont bien faibles.
Toutefois « Dieu garde ceux qu’il aime ». Au brillant jeune homme égaré dans une société corrompue et corruptrice, la Providence envoya le compagnon de son âme, qui devait le soutenir et l’encourager: ce fut un jeune prêtre nommé l'abbé Quinet. Les deux amis étaient déjà attirés l’un vers l'autre par une vive et profonde sympathie, quand le coup terrible dont il était frappé jeta le jeune homme tout entier dans le refuge qui lui était offert.
D’ailleurs, aux études sévères des mathématiques, il aimait à joindre les lectures littéraires; il suivit à Saint Sulpice les Conférences religieuses de l’abbé Frayssinous,
dont l’éloquence élevée et pressante lui laissa des souvenirs qu’il retrouvait encore vivants et passionnés dans ses derniers jours.

L’abbé Frayssinous

Défense du Christianisme et Conférences par l`abbé Frayssinous
A la fin de 1810, Paqueron quitta l’École polytechnique pour entrer à l’École d'artillerie de Metz: son numéro d'entrée avait été 35, il en sortit le cinquième, et ce succès fut la récompense d’une ardente application. Lieutenant d'artillerie à la fin de 1811, c’est—à-dire à l’âge de vingt ans, il était considéré comme appelé au plus bel avenir par ses camarades, que charmait une heureuse union des qualités sérieuses de l’esprit avec l’entrain et la bonne grâce d’une inaltérable gaieté.

École d`Artillerie de Metz
Bientôt la fortune des armes le conduisit à Dantzig pour y subir toutes les horreurs d’un long blocus, où la famine était si cruelle que les soldats se disputaient comme nourriture les chevaux de leurs officiers. Ce fut au milieu de ces circonstances douloureuses que l’énergie et la bravoure de Paqueron lui valurent, à vingt-deux ans, les épaulettes de capitaine.
A cette brillante récompense de ses efforts Paqueron répondit par un redoublement d’énergie; et quand, le 2 janvier 1814, par un froid de 21 degrés, à cinq heures du matin, l’héroïque garnison de Dantzig dut prendre la route de l’exil, le jeune capitaine ou il fit à ses camarades et à ses soldats l’exemple vivifiant d’une patience et d’une sérénité d’âme qui releva les courages et repoussa le désespoir.
Cependant ses forces n‘étaient pas toujours à la hauteur de son énergie: une attaque de typhus faillit l’enlever et le réduisit à un état de maigreur qui le rendait méconnaissable, quand, le 30 septembre, il franchit le Rhin pour revoir son foyer d’Ancerville dévasté par le passage des armées ennemies. Cependant, le 19 août 1815, le jeune capitaine fut rappelé sous les drapeaux et envoyé au Havre pour travailler à l’armement de la place. L’ère des batailles était close. Qu’était-ce que cela pour un homme qui n’avait au cœur que deux pensées: Dieu et la patrie!
2 - SES PREMIERS MALHEURS
L‘aurore de la gloire militaire avait eu pour Paqueron toutes ces douceurs dont Vauvenargues conservait le souvenir et le regret; cette aurore ne connut pas de lendemain. Pendant trente-cinq ans, le brillant officier fut enfoui dans les travaux ingrats de l’artillerie et du service des poudres. A cette obscurité sans retour vinrent se joindre les coups redoublés de la douleur. Ce sont ces années stériles pour la gloire du monde, qui furent les plus riches et les plus fécondes pour cette vertu chrétienne qui a fait au vieux soldat une auréole impérissable.
Ce que voit le monde, c’est que, à l’éclat de ses débuts militaires, le génie souple et vivace de Paqueron substitue le mérite sérieux d’un administrateur intègre, d’un savant ingénieux, d’un officier tout entier aux devoirs de sa profession. Pour Dieu et pour la religion, Paqueron donna le plus noble témoignage d’une énergie morale qui ne laisse pas même voir ses efforts; car, la mort dans l'âme, il resta debout et ardent à sa tâche de chaque jour, attendant que Dieu le relevât de son poste.
C'est le 6 décembre 1816, qu’avec sa nomination d’inspecteur à la poudrerie de Saint-Jean-d’Angely, Paqueron, âgé de vingt-cinq ans, reçut la direction définitive de sa vie et entra dans la carrière Où il devait vivre et mourir. Ses vertus trouvèrent le moyen de s’y déployer; avec que! éclat, nous allons le voir.
La première occasion de montrer l’héroïsme de sa charité lui fut offerte le 25 mai 1818. La ville de Saint Jean-d’Angely était épouvantée par un violent incendie qui s’était produit après l'explosion de la poudrerie. D’une minute à l’autre on attendait des explosions nouvelles qui pouvaient faire sauter la ville: la terreur paralysait tous les courages. Seul le jeune inspecteur monte sur le toit du magasin à poudre que la flamme gagnait; seul, sur le volcan, avec un inaltérable sang-froid il poursuit toutes les étincelles, toutes les flammèches, couvre de linges mouillés des barils qui contenaient 1,500 kilogrammes de poudre, et sauve ainsi la ville d’un désastre épouvantable.

La ville de Saint Jean-d’Angely
Appelé aux fonctions de directeur des poudres et salpêtres à Paris, il eut à peine le temps d'y établir la femme que le ciel lui avait fait rencontrer, comme la digue compagne de sa vie, lorsqu’il fut frappé presque en même temps dans ses deux familles: c’est la loi; en étendant nos relations et nos joies, nous étendons et multiplions les prises offertes à la douleur. Une des plus cruelles épreuves fut celle qui, après six années d’union bénie par le ciel, enleva sa compagne a ce père de famille de trente-quatre ans. Les termes dans lesquels il exprime sa pieuse résignation méritent d’être conservés: « Combien de coeurs, 0 mon Dieu, vous demandaient alors la conservation de cette admirable femme! Vous n’avez point jugé dans votre sagesse infinie devoir exaucer nos prières; vous savez mieux que nous ce qui nous est nécessaire, et puisque toute votre conduite sur les hommes ne tend qu’à les rendre meilleurs, ne dois -je pas, malgré mes douleurs, vous remercier de votre conduite envers moi? »
Un ami donnait l'explication de cette résignation héroïque, en lui écrivant le 7 octobre 1825: « Votre foi vous a soutenu, et vous trouvez la paix où d’autres n’auraient trouvé que le désespoir... Combien la religion éleva l’âme au-dessus d’elle-même! »
Cinq mois après, Dieu lui enlevait encore son père, et, suivant l'expression de son ami, « c’était un consolateur visible de moins, mais une force réelle de plus, un nouveau protecteur dans le ciel. »
Après la mort de son père, Paqueron n’eut plus qu’un désir, réunir sa jeune famille à la famille de sa femme et rejoindre son beau-père à Angoulême. Quand il eut ainsi perdu tous les compagnons de sa vie et la plus intime confidente de ses pensées, Paqueron chercha à combler cet irréparable vide, en fixant dans un journal de sa vie les images de sa mémoire, les tristesses poignantes de son cœur et les aspirations généreuses de son existence nouvelle. C’est à partir de ce jour que Dieu prit la plus large place dans une vie consacrée à toutes les pratiques de la perfection chrétienne.
III
SON JOURNAL
Le journal de Paqueron est un monologue sincère de près de quarante ans; c'est une discussion de ses pensées et de ses sentiments, dont la sévérité même révèle, à son insu, toutes les délicatesses de cette grande âme. Il dit en commençant : « Que faire seul, le soir, dans cette chambre où je vois toujours un cercueil?... Des images funèbres peuplent ma solitude; mon cœur est plein de tempêtes... Je n'ai plus sur terre d’autres confidents que ce morne papier. »
Le spectacle de cette noble existence, la lecture de ces généreuses pensées est un aliment sain et fortifiant pour l’âme. Voici quelques extraits de son journal :
« L’essentiel, ici-bas, n’est pas d’avoir une existence agréable, mais de rendre son existence utile. Celui qui ne sait pas mettre à profit son temps et ses forces pour se rendre meilleur et faire du bien à ceux qui l’entourent, est complètement indigne de vivre. Un admirable moyen de se rendre chaque jour meilleur, c’est de scruter avec soin sa conscience et de juger impitoyablement par écrit ses actions quotidiennes. Rien n’est plus efficace que cette pratique; elle ramène et fixe la pensée toujours errante, elle développe le sens moral, elle met l'âme en possession de ses forces, et lui rend cette paix intérieure qui est préférable à tous les biens. »
« Il est nécessaire, en outre, de récapituler les observations des semaines, des mois et des années, pour constater les profits et les pertes, pour démêler les influences bonnes et mauvaises qui agissent sur nous et nous modifient sans cesse, et souvent à notre insu. Qu’il faut d’énergie et d'opiniâtre attention pour arriver simplement à connaître ce qui se passe en nous! »
D’ailleurs, ce n’était point un songe creux celui qui écrivait : « Dans la vie, tout ce qui ne passe pas en acte est perdu. »
En effet, toute l’énergie d’une grande âme éclate dans sa règle de conduite : « Qui ne sait pas être esclave de son devoir, ne sera jamais maître de ses passions: on ne règne d’un côté qu’en servant de l’autre. »
De même, son ardeur pour le travail trouve des expressions d’une heureuse énergie : «Il faudrait faire entrer mille ans dans chaque année, pour utiliser vraiment la vie et réaliser quelque chose qui demeure : Laboremus, labonmus! »
Religieux volontaire, il se trace un règlement, et son emploi de la journée offre le guide le plus édifiant :
« A cinq heures, je me lève et je prie Dieu, c’est ma force. Je lis ensuite une heure dans la Bible de Vence; vers sept heures, j’habille Charles et je le fais prier. Je donne une heure à mes correspondances officielles, une demi-heure ensuite à l’écriture de Charles, et de neuf heures et demie à onze heures et demie, j’expédie toutes les affaires de bureau. Durant ce temps, Charles travaille; je le fais réciter de onze heures et demie à midi; puis nous dînons ensemble. De midi à une heure et demie, récréation au jardin. Immédiatement après, je donne une nouvelle leçon à Charles, et de deux heures et demie à six heures du soir je suis livré à mes devoirs de surveillance et aux travaux actifs de ma vie officielle. Vient le souper, suivi d’une demi-heure de promenade avec mon fils. Nous rentrons; nous prions Dieu ensemble. Charles se couche; et de huit heures à dix heures je lis quelque ouvrage sérieux dont je fais l’analyse par écrit. Je termine ma journée par deux chapitres de l’Évangile, et je m’endors dans mes souvenirs de Nazareth ou du Calvaire, sans avoir senti trop lourdement le poids de ma pauvre vie. » (16 octobre 1825.)
Au sentiment profond de ses devoirs il joint une touchante modestie : « M‘instruire de plus en plus de mes devoirs et m’appliquer à les bien remplir, voilà toute la réalité sérieuse de la vie..... le sommaire de mes devoirs. ——Y en a-t-il un seul que je puisse me flatter d’avoir bien rempli? Qui dira toutes les défaillances de ma volonté et toute la fragilité de mes résolutions! »
Mais Dieu est son soutien: « Quelle force me donne cette conviction de la présence de Dieu! Malheur à l’homme qui vit seul et qui ne sent pas près de lui cet adorable voisinage l Que peut-il faire dans son isolement et quelle puissance terrestre est capable de relever son cœur? Moi, Seigneur, je sens bien que je ne suis fort qu’avec vous et en vous..... Soyez près de mon âme, Seigneur; et que je sente votre main et vos yeux sur moi»
Écoutez ces touchantes invectives d‘une âme rigoureuse pour elle-même jusqu’au scrupule : « Me voilà bien tel que je suis avec mes ridicules prétextes et mes éternels raisonnements! Je prétends que je suis trop occupé; mais le suis-je trop pour me promener chaque jour pendant une heure ou pour vaquer à ce qui plaît à ma nature? Est-ce que le temps qu’on donne à Dieu est perdu pour les devoirs officiels? Autant vaudrait soutenir que le temps des repas est perdu pour la vie physique. Prier Dieu, c'est prendre des forces pour tous les devoirs qu’on doit accomplir. »
« Mon vrai bonheur à l’avenir n’est que dans le bien que je puis faire autour de moi, à mes enfants, à mes proches, à mon pays. »
Tel était l’objet de son étude incessante et de son généreux labeur: « Ce n’est point l’augmentation de la fortune qu’il faut chercher dans le travail, cela le rabaisserait singulièrement. Ce qu’il y faut chercher avant tout, c’est l’accomplissement d’une loi positive de Dieu; c’est surtout l’expiation de nos fautes. Quiconque ne voit pas l’activité humaine de ce point de vue est incapable de la comprendre et incapable de l'honorer. »
Que de leçons proposées avec une précision heureuse et qui réunissent toutes les qualités : raison, sentiment, style : « Pour exclure le vague de ses pensées et empêcher l’inutile évaporation de son temps », aucun sacrifice ne lui coûte. Fidèle à cette rude prescription de Saint-Cyran:
« Défiez-Vous de vos larmes », il fait la part très étroite aux exigences légitimes de ses regrets.
Ma douleur, qui chaque jour grandit au lieu de s’apaiser, dévorerait stérilement ma vie, si je ne résistais à ses étreintes. Rien ne peut me défendre contre elle, comme la puissance des règles. Il faut que j’attache ma nature par des liens de fer et que je l’enferme dans d’inflexibles pratiques : si les idées et les principes clairs agissent singulièrement sur la conduite des hommes, il est également vrai que la conduite réagit à son tour très puissamment sur leurs idées et sur leurs sentiments; c’est ce que nous ne savons pas assez.
Bien vivre fait infailliblement bien penser et noblement sentir : soyons fermes sur les pratiques.
Il se reprochait un jour d’avoir rêvé d’accroître sa richesse par une spéculation commerciale: « Telle est la misère de l’homme qu’il se laisse séduire par des objets qui ne peuvent rien pour son bonheur. Qu’est-ce que peut tout l’or du monde pour la joie véritable de notre âme? Un grand élément de bonheur, c’est une bonne conscience délivrée de fautes et qui tient sous le joug toutes les passions : voilà le trésor qu’il faut ambitionner. »
Sa science, égale à sa modestie, lui donnait le droit de dire aux savants : « La lumière suit l’abnégation et l'humilité ; elle monte en baisse avec elles, et le meilleur moyen
de devenir savant c’est de devenir pieux» le Seigneur a dit : « La vérité est cachée aux superbes; mais elle est révélée aux petits. »
« L’aveu franc et sincère de notre ignorance est bien préférable pour nous et plus honorable aux yeux des hommes qu’un caquetage continuel qui ne sert qu’à montrer notre vide et à nourrir notre vanité.»
IV
SA VOCATION RELIGIEUSE
Enfin, au commencement de l’année 1829, appelé à l’inspection d’Angoulême, Paqueron eut hâte de quitter cette ville de Marseille Où il avait rendu tant de services,
mais où il avait tant pleuré.
Alors, à l'âge de trente-huit ans, commence pour lui une existence nouvelle; elle s’élargit, s'étend et se complique de ses devoirs de père de famille et des obligations d’une mission qui se révèle à lui d‘une façon plus vive que jamais; il écrit: « 0 mon Dieu! prenez dans ma vie la place de mes chers absents; prenez le temps, prenez les forces que je leur aurais consacrés. Plus vous m’avez été, plus je veux vous donner, afin de retrouver en vous tout ce que j’ai perdu. ».....
« Je n’aurais pas cru pouvoir m’oublier ainsi; les semaines et les mois s’évaporent comme si j’étais heureux. «Qui sait même si je ne le suis pas? C’est Joubert, je crois, qui a dit : « On n’est guère malheureux que par la réflexion. » Et de vrai, quand j‘évoque le passé, je sens un vide affreux; mais quand je m’enferme dans le présent, quand je regarde près de moi le front pur de mes enfants, et là-haut, sur leur colline, ces vieilles églises.
Lorsqu’il est envoyé en Algérie, sur la terre d’Afrique, tous les faits sont, pour cet esprit pénétrant, pour cette âme généreuse, des occasions d’étude et de réflexion. Il a le talent de la description poétique tout comme tant d’autres talents, et sa piété donne à ses descriptions un éclat plus touchant et plus vif :
«Je n’oublierai jamais ma journée d’Hippone. Je m’attendais à un pays désert, j’ai trouvé la plus florissante vallée du monde, un bassin plein de soleil, d’aubépines séculaires, de vertes prairies, de blés jaunissants au pied de l’Atlas et en face de la Méditerranée, magnifique Éden où la Providence avait placé le plus grand des hommes nouveaux ( St-Augustin) après saint Paul! Voilà le point d’où ce flambeau a rayonné sur le monde. Je questionne les Maures que je rencontre ; ils ont gardé parfaitement le souvenir du grand chrétien, Roumi Ke’bir, qui glorifia ce rivage, et ils l’invoquent comme un puissant ami de Dieu. »

Hippone en Algérie actuelle - L`endroit ou vivait au temps de l`empire romain St-Augustin - ce grand docteur de l`Église
C’est à Hippone qu’il formule ces principes d'une haute philosophie de l'histoire :
« Quelle démonstration catholique je vois et je touche ici! Il y a eu sur ces rivages une admirable civilisation, une prospérité matérielle et morale créées et soutenues pendant des siècles par le christianisme ; dès que Mahomet a pris la place de Jésus-Christ, la barbarie est venue, et mes yeux la contemplent : où l’Église avait fait la vie, l’Islam fait la mort. Qu’on dise donc que les doctrines sont indifférentes, et que les gouvernements peuvent sans danger se détacher de l’Église. Tout est dans les doctrines, dans les religions surtout : la question religieuse est une question de vie ou de mort, plus visiblement peut-être encore pour les nations que pour les individus. »
A la suite d’études, de voyages, de travaux et de recherches poursuivis en Afrique avec une ardeur infatigable, au lieu de réclamer une récompense, Paqueron se trouve. très heureux de rentrer à la poudrerie d'Angoulème : « Me voici rendu à mes ouvriers et à mes poudres: j’ai mon foyer rétabli, j’ai ma fille près de moi que je garde et qui me garde..... Je mets Dieu dans mes travaux. Que me fait tout le reste du monde ? Notre-Seigneur colore et poétise jusqu’à mes labeurs vulgaires. Que le bon Dieu est bon!»
Son détachement des biens du monde était absolu et sincère : «Je ne veux de la terre, que tout juste ce qu’il en faut pour aller au ciel..... L’avancement viendra quand Dieu voudra, et quant à la gloire, j‘ai la mienne la, dans le témoignage de ma conscience. »
Aussi son inaltérable bonne humeur trouvait des mots charmants. Relevé comme mort, à la suite d’une chute sur la tête, il disait en revenant à la vie : « Le bon Dieu ne m’a pas trouvé mûr pour l’éternité. »
Mais l’humilité chrétienne et l’indépendance de caractère ne sont pas des recommandations qui aient cours auprès des gouvernements modernes; malgré ses services exceptionnels, ce ne fut qu’à cinquante-quatre ans que le brillant capitaine de Dantzig fut nommé lieutenant-colonel, et il attendit vingt-huit-ans la rosette d’officier de la Légion d’honneur. « C’est bien un peu long, disait-il; mais il y a beaucoup de ma faute. J’aurais dû (si j’avais pu!) me conformer à l’usage commun, et manifester au moins un désir; j'aurais aujourd’hui dix ans de grade. »
Comme sa sincérité religieuse était au-dessus de tout respect humain, Paqueron eut le droit de conseiller la même vertu a son fils. Lorsqu’en 1839, Charles fut reçu à.
l’École polytechnique, où les sentiments religieux étaient assez mal vus, Paqueron écrivit à son fils : « Arbore ton drapeau tout de suite, afin que l’on sache qui tu es. Il faut qu’après quarante-huit heures, aucun de tes camarades n’ait un doute à ton sujet. C’est l’unique moyen d‘éviter les positions fausses et les engagements équivoques. Sois chrétien simplement, mais franchement. Parler comme on croit et agir comme on parle, voilà la meilleure logique du monde et celle qui produit toujours grand effet. Pas de faiblesse surtout! Quand on a l’honneur d’être chrétien, il ne s’agit pas de se, faire pardonner ou tolérer; mais bien de se faire respecter. N’aie pas peur de passer pour singulier. Voici plus de quarante ans que, pour ma part, je suis très singulier, et ni Dieu ni les hommes ne m’en ont encore puni. »
Tous les instituteurs de l’enfance devraient avoir présente à l’esprit cette belle parole : « Dieu a mis dans l’âme des enfants l’obéissance et la pureté; malheur a qui leur fait perdre l’un ou l’autre! il tue sans remède l’homme dans l’enfant. »
Comme la piété simplifie et élève les principes de l’éducation : «: Il me semble que mes devoirs de père se réduisent tous a un seul: défendre les intérêts de Dieu dans le coeur de mon fils. C’est protéger d’un seul coup et sauver à la fois les droits de mon fils et mes propres droits de père : tout est harmonie dans le bien.»
Aussi, que de bon sens dans ces conseils à son jeune élève de l’École : « Sois bon camarade, de relations faciles, d’esprit large, et travaille en conscience pour remplir les vues de Dieu, préparer ton avenir et servir utilement ton pays. De la science, de la gaieté, de l'amitié franche, mais pas de politique dans les conversations ; tu feras de la politique plus tard; l’art de déraisonner ne passera pas sitôt de mode. »
Sa règle de conduite étant bien simple, il la conseille à son fils : « Dans tes luttes, il n’y a pas à hésiter : prends toujours le parti de Dieu contre toi-même, aussi bien que contre les autres. C’est le seul parti de l’honneur et de la victoire. C’est aussi le seul parti de ton père, tu me trouveras toujours de ce côté. »
La plus éloquente des leçons est la leçon de l’exemple; avec quelle franchise le père la donne à son fils : « Ne te décourage pas, mon cher et bon Charles; Dieu ne demande pas le succès, mais le travail plein d’ardeur et d'opiniâtreté. J’ai eu comme toi mes lassitudes et mes dégoûts; j’ai triomphé de tout par la patience et par une imperturbable confiance en Dieu. Je me suis toujours dit: « Si je travaille bien, avec des intentions droites, Dieu me bénira; il ne pourra pas s’y refuser; et, dans cette conviction, j’ai trouvé sans cesse du courage plein mon coeur. Mets simplement le bon Dieu en mesure de s’exécuter, et tu verras! C’est encore la politique de ma barbe grise. »
La justesse et la force de l'expression répondent à l’élévation de la pensée, quand il dit avec l'énergie d’un Pascal: « Soyons logiques toujours, et allons bravement jusqu'au bout. Pas d’à peu près, surtout en fait de dogmes et de morale... Les demi-vérités, les demi-croyances, les demi dévouements, bagage des âmes peu formées qui appellent modération ce qui n’est que lâcheté ou impuissance. »
Voilà en quelques lignes un traité de pédagogie morale qu’on aurait quelque peine à remplacer par les platitudes de la libre-pensée.
Sur l’alliance entre la science et la foi, en ne peut mieux dire ni avec un esprit plus piquant lorqu‘on est élève de l’École polytechnique : « Les mathématiques, qui forment le jugement pour l'ordre abstrait, le déforment souvent et le faussent pour l’ordre moral. Il y a autre chose à faire ici-bas que des ponts et des digues; tel habile ingénieur capable des plus beaux travaux peut n‘être qu’un imbécile dans la vie pratique. Étudions les mathématiques pour l’utilité sociale; mais étudions en même temps la religion pour l’utilité personnelle. La science abstraite ne répond qu’à quelques-uns des besoins intellectuels de l’homme; la religion répond à toutes ses aspirations. Le savant sans religion n’est qu’un animal perfectionné, espèce fort dangereuse; le chrétien même ignorant est un homme civilisé, agréable à Dieu, utile à ses frères et fort commode aux gouvernements.»
Nul moraliste n’a mieux senti et mieux rendu l’harmonie profonde qui unit le bonheur au devoir : « Quel est l’attrait qui manque au devoir? Cherchons-nous le bonheur? il y est. Le progrès de l’âme? il y est. La vraie gloire? on l’y trouve. Dieu lui-même enfin? il y est aussi, et il nous y attend, comme caché au fond, car tout devoir accompli mène à Dieu. »
Sur la piété, ni saint François ni sainte Thérèse n’auraient pu rencontrer un développement plus éloquent:
« La piété est un amour de Dieu poussé jusqu’à l’enivrement et à la béatitude intérieure. Ne pas arriver jusque-là dans la vie chrétienne, c’est n’arriver à rien du tout. Est-ce que Dieu n’est pas descendu pour nous jusqu’à la folie de la Croix ? Oui certes. La seule mesure de l’aimer après cela, c’est de l’aimer sans mesure. »
Une sorte de splendeur mystique illumine certaines de ses lettres à son fils :
« Nous sommes allés à la sainte table ensemble ta sœur et moi ; c'était le dix-neuvième anniversaire de la mort de ta mère. Je ne sais ce qui s’est passé ; mais mon émotion, les grâces de Dieu, les souvenirs d’autrefois, tout s’est mêlé et confondu dans une abondance de vie, dans une intensité de joie que je ne saurais jamais dire. J’ai eu comme l'avant-goût du ciel. Quel admirable mystère que la sainte Eucharistie l Je ne comprends pas, mais je sens et je suis heureux. »
La pensée de la mort étant toujours présente à son cœur, tous les accidents qui frappaient autour de lui devenaient autant de leçons : «Qu’importe la différence d’âge? Disait-il; la Providence ne m’a pas signé de bail. Soyons prêts à toute heure ; c’est la vraie sagesse de la vie présente. »
Pour s'encourager à donner beaucoup, il se répétait une formule pittoresque qu’une pauvre vieille lui avait dite comme remerciement: « Ce qu’on mange pourrit, ce qu’on
donne fleurit! »
Moraliste chrétien, Paqueron flagelle de coups impitoyables notre vaniteuse faiblesse; il veut mettre son fils à l’abri de cette irritabilité nerveuse qui conduit à l’imbécillité :
« Du calme et une ferme confiance en Dieu. Défendons nous des impressions de chaque heure ; l'impressionnabilité est une maladie de ce temps, elle ruine la vie morale qui a besoin de fixité et d’appuis permanents.»
« Nos pères étaient forts et résistants par l’âme, parce qu’ils avaient moins d’idées flottantes que nous et plus de croyances, moins de sentiments vifs et plus de sentiments constants. Leur vie était appuyée à d’immuables principes, attachée et vouée à d’éternelles beautés; les coups de vent de la fortune privée ou des événements publics passaient sur elle sans l’ébranler. Je puis tout en celui qui me fortifie telle était sa devise.»
« Aujourd'hui, détachés de Dieu et réduits à nos propres misères, nous sommes en même temps vains et peureux; nous commençons fastueusement et nous finissons misérablement. Le moindre souffle nous renverse et nous emporte. C’est pitié de nous voir rouler dans un tourbillon d’impressions et d’idées changeantes, aspirant à nous accrocher à tout et ne nous fixant à rien, passionnés, dirait-on, pour tout, et pourtant n’aimant rien, vieux enfants, sans l’innocence du jeune âge, sans la sagesse des vieillards. »
«Soyons plus forts que ce temps et ne séparons notre cœur ni de nos dogmes, ni de nos espérances, ni de nos devoirs : ce sont les trois grandes attaches de la vie. »
Il faut voir avec quelle pénétration admirable il devine en 1849 les périls du voltairianisme et de l’irréligion
« Les tendances de l’enseignement public, celles du Collège de France en particulier, me jettent dans l’épouvante. On rit niaisement des doctrines modernes; autant vaudrait rire de la foudre, quand elle gronde et qu’elle est près d’écraser le navire. Ces leçons de philosophie, tout émaillées de traits d’esprit décochés contre les catholiques, sont des sacs de poudre placés en plein jour sous les murs de l’Europe. On n’y prend pas garde aujourd'hui ; on sautera en l’air demain. »
Jamais la misère morale de notre temps n’a tiré d’une âme chrétienne une plainte plus sincère et plus touchante. C’est le cœur de Fénelon qui parle la langue de Joseph
de Maistre :
« Rien n’est plus triste que l’état de ces maisons déchues où le superflu reste quand le nécessaire est parti. Le contraste entre ce qui survit du luxe ancien et les tortures de la misère présente est horriblement douloureux. On dirait une dérision de la fortune d’hier insultant au malheur d’aujourd’hui. C’est l’état de ce siècle où le superflu abonde; mais où le nécessaire manque. Dés sciences, des arts, de l’industrie, une grande civilisation au dehors ; et pas de principes, pas de bon sens au dedans. De la littérature et point de vérités; des bijoux et pas de pain. Que de fripiers qui jouent au millionnaire avec de vieilles loques! Triste, triste! De la science, oui; de l’art, oui; du commerce, oui; je veux bien de tout cela; mais, avec tout cela, j‘ai faim, et je veux le pain de vie. Vieux enfants, sans l’innocence du jeune âge sans la sagesse des vieillards. »
La société contemporaine est tout entière dans ces traits d’une vérité désolante.
Après le mariage de sa fille, Paqueron, promu au grade de lieutenant-colonel, fut appelé, en 1846, à la direction de la capsulerie de guerre à Paris. Plein de sécurité pour l’avenir de ses deux enfants, il ne vit dans cet avancement qu’un nouveau moyen de donner à Dieu tout ce qui lui restait de forces.
Il semblait en vérité qu’il prit pour devise et règle de conduite le mot d’un moraliste : « Toute vie à sa grandeur, et comme il t‘est impossible de sortir de Dieu, le mieux est d’y élire sciemment domicile. »
Quelques mois après sur la proposition spontanée de S. A. R. le duc de Montpensier, président de la Commission pour l'étude du pyroxyle ou poudre-coton, Paqueron fut nommé colonel, à l'âge de cinquante-six ans. D’ailleurs rien n’était changé dans sa vie, où la religion occupait dès longtemps la première place. Uni de cœur et de croyance aux membres de la société catholique de Paris, il en admirait les vertus et il écrivait à ses enfants : « Si toute la bourgeoisie française était animée du même souffle, la France serait sauvée.»
Malgré l’ardeur de son dévouement, il ne se dissimulait pas la nécessité d’un secours de Dieu : «La science orgueilleuse n’aboutira jamais à rien pour le salut du monde. L’avenir appartient aux humbles de cœur. Celui qui se fait petit devant Dieu, qui prie en secret, qui communie pour les pauvres, est plus utile à la société que les plus beaux philanthropes du monde. »
Il sentait que rien n’est petit pour les grandes âmes, et que la charité ennoblit tous les travaux. Pendant deux ans, à Paris, il s'occupa seul de ce qu’il appelait l’Œuvre des Souliers, recueillant lui-même les vieilles chaussures, les faisant réparer, les nettoyant de ses mains et les portant ensuite à ses pauvres. « J’en ai quelquefois jusqu’à douze et quinze cents paires sur mes planches, disait-il en riant, et je frotte, je frotte! »
D’ailleurs, voici comment il profitait des amusements de Paris. Un officier général de ses amis le priant de l’accompagner au théâtre : «Volontiers, dit le colonel ;mais ayez seulement la complaisance de venir avec moi dans une maison où j’ai affaire pour quelques minutes. »
Et il conduisit son ami dans un misérable réduit de la rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, où une mère et cinq enfants pleuraient près du lit d’un père malade depuis longtemps.
La scène était navrante. « Si nous laissions ici l’argent du spectacle? dit Paqueron dans l’oreille de son ami. Allons! dit celui-ci, allons! c’est un traquenard de votre façon; inutile d’essayer d’en retirer la patte! » Et il lui remit trois pièces d’or dans la main.
Dans les moments trop douloureux de la vie, pour soutenir sa résolution, à ses prières il joignait des sacrifices de charité.
Témoin ému de la révolution du 24 février 1848, il en mesura toute la profondeur avec une sagacité dont bien peu d’homme politiques furent capables :
« La houle est enfin tombée; mais dans la rue seulement nous avons de l’orage pour longtemps dans les âmes... La Révolution cette fois n’a rien profané, c’est vrai; elle n’a peut-être pas cassé les vitres d’un seul presbytère de village; mais il ne faudrait pas s’y méprendre pourtant, elle n’en est pas moins l’antichristianisme vivant. Elle ne met pas la main sur les prêtres ; mais elle menace de renverser de fond en comble l‘ordre religieux... C’est peut-être la plus large attaque doctrinale contre l’Église qu’il y ait eu depuis Notre-Seigneur. Quelle est la question cachée dans les vapeurs de cet orage? Si je ne me trompe, c’est celle-ci : « Ne pouvons-nous pas, ne devons-nous pas faire notre bonheur sur la terre, en dehors des solutions chrétiennes et des formes sociales inspirées jusqu’à présent par elles? » Ce n'est point une question politique, c’est tout simplement une question théologique, et cette question jetée dans les débats publics de ce temps, c'est du fulminate de mercure disséminé dans l’air. J’ai bien peur pour l’avenir. »
Quand, aujourd’hui, nous rapprochons ces pronostics du cri féroce et stupide « le cléricalisme c'est l’ennemi »; quand nous assistons aux persécutions qui l’ont suivi; comment ne pas reconnaître que Paqueron avait vu très juste et que les vingt années du second Empire n’ont été qu’un temps d’arrêt dans la marche de la Révolution, c’est-à-dire dans la ruine de la France ?
Source : Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme siècle - A. PELLISSIER - Professeur de l’Université - Honoré d‘un prix Montyon par l'Académie Française en 1885
( Extraits)
1 - LE COLONEL PAQUERON – UN EXEMPLE DE VIE CHRÉTIENNE
2 - FRÉDÉRIC OZANAM – PROFESSEUR ET FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL QUI LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
PRÉFACE
Ce livre est le nobiliaire de la France chrétienne. Il s’adresse à tous les gens de bonne volonté. Les lecteurs de bonne foi y trouveront dans le détail, des faits historiques et des vérités morales de premier ordre ; ils y trouveront dans l’ensemble, la solution d’un problème capital, le problème de notre avenir.
Quand parfois il a le bonheur d’échapper au tourbillon de la vie au jour le jour, tout Français se pose cette redoutable question: « Où allons—nous? Vers quel avenir la France est-elle entraînée? Pourquoi nos pères et nos aïeux ont-ils été meilleurs et plus grands que nous? » Au nom de l’histoire et de la raison, ce livre vient répondre: « Parce qu’ils ont été plus chrétiens »; et cette réponse vaut à la fois et pour la glorification de nos pères et pour l'éducation de nos enfants; car Dieu a fait les nations guérissables.
A cet effet, rien de plus efficace que le récit des beaux exemples. Les faits sont des témoins qu’on ne peut récuser ; et si ces témoins proclament que le sentiment religieux développe, exalte et féconde les penchants supérieurs de la nature, que le christianisme et le plus puissant auxiliaire du patriotisme, du dévouement, du courage militaire et de la Charité; ne concevra-t-on pas que c’est le plus révoltant mensonge que de présenter le Christ comme l’ennemi de la civilisation ?
Or, c’est l‘esprit chrétien qui produit pour l’honneur de la France des soldats comme Paqueron et La Moricière, des marins comme Marceau et Courbet, des politiques comme Montalembert, des professeurs comme Ozanam, des administrateurs comme Cochin, des commerçants comme Chardon-Lagache, des artistes comme Hippolyte Flandrin.
Ces études sont pures de tout esprit de parti politique, parce que la vérité, la religion et la France sont au-dessus de toute espèce de forme de gouvernement. L’un des mensonges les plus criminels de certains sectaires est de soutenir que l’Église est l’ennemie de la République et que la religion est hostile à la démocratie: l’Église et la religion ne sont ni monarchistes ni républicaines : elles veulent le règne de Dieu sur la terre, elles sont pour la justice, pour l’ordre, pour la liberté; mais par cela même, elles sont contre l’esprit révolutionnaire.
Oui, au nom de la vie et de la mort, nos enfants ont à choisir entre le Christ et la Révolution, entre l’Évangile, qui est le code de la liberté, et la Déclaration des droits de l’homme, vide et dangereux programme de l’anarchie et du despotisme de la franc-maçonnerie.
Il y a deux manières de persuader : l’une insinuante et plus sûre, convient au service des intérêts humains; elle ménage et prépare le succès par des détours qui ne permettent pas au lecteur de voir où on le conduit; l’autre, plus périlleuse, attaque le mal en face et proclame loyalement son but. Je dois avouer que c’est la seconde méthode que je préfère et que j’ai toujours employée. Notre génération n’a pas besoin d’être encouragée dans sa suffisance et son inertie; elle a plus à profiter d’un bon conseil que d’une adulation banale.
Sans les traiter en ennemis, je suis obligé de condamner les tièdes; ceux qui croient que tout s’arrangera, que nous traversons une crise, que le démon (l`ange déchu) n’est pas aussi mauvais qu’il est noir, que la bonne manière de faire le bien, c’est de le faire en douceur... Dès longtemps La Fontaine leur a répondu :
La paix est fort bonne de soi,
J'en conviens; mais de quoi sert—elle
Avec des ennemis sans foi.
Profonde observation morale, d’où la conclusion : «Il faut faire aux méchants guerre continuelle»

Jean de la Fontaine - Les Fables (1621 à 1695)
« C’est une fausse piété, disait encore Pascal, de conserver la paix au prix de la vérité.»

Blaise Pascal - Pensées - (1623 à 1662)
La pire chose du monde, c’est d’avoir un avocat peureux ou tiède : par de tels défenseurs les procès s’éternisent. Dieu nous préserve aussi d’un certain genre tout nouveau d’optimisme : théorie des épicuriens vulgaires qui nous disent avec une résignation cynique : « Oui, c’est convenu; nous sommes en pleine décadence; mais laissez-nous... mourir en paix. » Non, mille fois non. Le vrai serviteur de la France est comme le médecin qui demeure auprès de son malade, tant qu'il lui reste un souffle de vie et d'espoir. Tout a été dit et bien dit sur les personnages historiques dont je parle : ils appartiennent au domaine de la vie ordinaire; je ne me suis donc fait aucun scrupule d'emprunter les faits aux écrivains qui les ont racontés.
Les historiens qui m’ont servi de guides sont tous animés du désir sincère de servir comme moi la cause de la France et de la religion.
A la fin d’un long et sérieux exercice de l’éducation publique et privée, comme fruit d’un travail qui n’a pas été sans succès, la conclusion qui m’est imposée par mon expérience, c’est que la doctrine chrétienne doit dominer et inspirer toute l’éducation de la jeunesse française. En bonne conscience, est-il une mère qui veuille souscrire à l’arrêt inhumain du législateur spartiate et jeter au gouffre le corps chétif de son enfant nouveau-né? Eh bien, femmes françaises, l'âme de vos enfants réclame mille fois plus de soins que le corps, soins affectueux, soins assidus, soins éclairés.
Honte et malheur à l’ineptie de nos Lycurgue ( Ancien roi de Sparte) contemporains, qui osent appeler respect de la liberté morale, l’abandon brutal des enfants à tous les entraînements de l’ignorance et de la passion.
Je voudrais au contraire, je voudrais apprendre à nos contemporains le chemin de l’Église, je voudrais ouvrir du moins ce port à nos enfants. Agissant ainsi, j’obéis à ma conscience, je remplis un devoir envers la patrie que je souffre de sentir abaissée dans le monde; devoir envers l'avenir; devoir envers la jeunesse française dont l’éducation a été la tâche de ma vie entière, tâche bénie, qui m’a valu le double honneur d’attirer sur ma tête les foudres municipales et les palmes académiques.
Si ces tableaux historiques éclairent, consolent, encouragent quelques âmes, si l’expérience apprend qu’ils peuvent faire un peu de bien, j’essaierai de continuer cette galerie des gloires chrétiennes de la France.
A ses « ennemis dans le mal triomphants », le chrétien peut dire comme Pascal: « Je suis seul contre trente mille; mais j’ai la vérité, et nous verrons qui l’emportera.»

LE COLONEL PAQUERON
I. Sa jeunesse. — Il. Ses premiers malheurs. —- 111. Son journal.
IV. Sa vocation religieuse. — V. Ses œuvres.
1- LA JEUNESSE DE PAQUERON
Voltaire voulait bien maintenir la religion comme la police à titre d’instrument social et politique; Rousseau comptait sur la raison naturelle et le sentiment pour assurer le parfait bonheur de l’humanité; Voltaire et Rousseau sont aujourd’hui détrônés par les athées anarchistes qui, réduisant la vie humaine à une suite de jouissances sans frein ni loi, ne veulent ni maître, ni Dieu.
A l'heure présente, l’opinion publique s’agite dans l’anxiété. Pourquoi ne prend-elle pas résolument le parti de s’engager dans la seule voie qui conduit au saint?
C’est qu'au milieu du chaos des sophismes, quelques esprits mal informés continuent à soutenir de bonne foi que la discipline catholique, supportable aux temps de croyance comme le moyen-âge, n’est plus tolérable à nos temps de science et de liberté, que les étroites pratiques de la religion répugnent aux esprits larges et ouverts, et que la raison émancipée rejette le joug de la foi.
Eh bien! s’il faut un témoignage simple et irrécusable à ces cœurs irrésolus, voici un homme d’un coeur ardent et d’un esprit très vif, qui a traversé dans sa jeunesse la société la plus dissolue de Paris, un homme qui a subi l'enseignement d’une école où l’irréligion était à l’ordre du jour, qui a suivi avec éclat la carrière militaire, qui a cultivé les sciences physiques et chimiques pour en tirer les plus ingénieuses applications, un homme qui, par un travail de soixante années, a mérité tous les honneurs que la vanité humaine peut décerner; et cet homme a été en même temps le catholique le plus fervent et le plus scrupuleux, cet homme n’a jamais négligé une seule des pratiques dont notre tiédeur et notre ignorance sont effrayées.
Rien ne prouve mieux combien la fidélité absolue au dogme et au culte catholique est en harmonie parfaite avec l’étude, avec la science, avec le progrès. Voilà l'enseignement qui ressort de la vie de ce soldat qui, pendant plus de soixante ans, a pris pour devise et pour règle de conduite: « Tout par Dieu et pour Dieu. Dieu est ma force, mon soutien et mon espoir. »
C’est donc le propre de la vertu chrétienne, d’avoir créé et mis dans le monde un genre d’hommes auxquels l’Église donne parfois le nom de saints, comme Louis IX, Thomas d’Aquin, François-Xavier ou Vincent de Paul.
L’histoire n’a pas trouvé de titres pour eux ; il serait juste de les appeler les grands hommes de bien. Tandis que la plupart des hommes mettent leurs aptitudes au service de leur fortune ou de leur gloire, ces vrais chrétiens dépensent la même fécondité d’esprit, la même puissance de caractère au service de leur pays et de leur prochain: hommes véritablement supérieurs, puisqu'ils ne demandent rien au monde et attendent de Dieu seul le prix de leur héroïsme modeste.
A côté, disons mieux, au-dessus des grands hommes de guerre, des grands hommes politiques, des grands hommes de lettres, la justice et la religion portent au premier rang les grands hommes de bien. Nicolas Paqueron naquit à Ancerville, en Lorraine, le 5 décembre 1791, dans une famille chrétienne dont la fortune avait été gravement compromise par les troubles qui agitaient la France entière depuis plus de deux ans.
Son âme fut donc trempée dès l’abord à la triple source de la foi, du travail et de la pauvreté.
Sur les instances bienveillantes d’un oncle maternel, qui était capitaine d'artillerie, en 1801, l’enfant fut envoyé à Paris pour se préparer à la carrière militaire en dirigeant ses études vers l’École polytechnique. Avec une ardeur et une assiduité que le succès vint récompenser, en moins de sept ans il eut achevé le cours de ses études préparatoires, et à la fin de l’année 1808, il entrait le vingt-quatrième à l’École polytechnique.
Mais son premier succès fut attristé par sa première douleur ; à la fin de l’année 1809, une mort presque soudaine enleva au jeune homme son protecteur et son guide, cet oncle dont l’exemple, les conseils et l'appui devaient l'accompagner et le soutenir. Cette perte lui fit au cœur une blessure qui ne se ferma jamais. Pour cette jeune âme de dix-sept ans, le mal de l’abandon était aggravé par la corruption morale du temps. Enivrée de gloire militaire, la société française, en 1809, n'avait d’autre dieu que le plaisir, et d’autres conseillers que des épicuriens éhontés. Quand la corruption est dans l’esprit public, les consciences individuelles sont bien faibles.
Toutefois « Dieu garde ceux qu’il aime ». Au brillant jeune homme égaré dans une société corrompue et corruptrice, la Providence envoya le compagnon de son âme, qui devait le soutenir et l’encourager: ce fut un jeune prêtre nommé l'abbé Quinet. Les deux amis étaient déjà attirés l’un vers l'autre par une vive et profonde sympathie, quand le coup terrible dont il était frappé jeta le jeune homme tout entier dans le refuge qui lui était offert.
D’ailleurs, aux études sévères des mathématiques, il aimait à joindre les lectures littéraires; il suivit à Saint Sulpice les Conférences religieuses de l’abbé Frayssinous,
dont l’éloquence élevée et pressante lui laissa des souvenirs qu’il retrouvait encore vivants et passionnés dans ses derniers jours.

L’abbé Frayssinous
Défense du Christianisme et Conférences par l`abbé Frayssinous
A la fin de 1810, Paqueron quitta l’École polytechnique pour entrer à l’École d'artillerie de Metz: son numéro d'entrée avait été 35, il en sortit le cinquième, et ce succès fut la récompense d’une ardente application. Lieutenant d'artillerie à la fin de 1811, c’est—à-dire à l’âge de vingt ans, il était considéré comme appelé au plus bel avenir par ses camarades, que charmait une heureuse union des qualités sérieuses de l’esprit avec l’entrain et la bonne grâce d’une inaltérable gaieté.

École d`Artillerie de Metz
Bientôt la fortune des armes le conduisit à Dantzig pour y subir toutes les horreurs d’un long blocus, où la famine était si cruelle que les soldats se disputaient comme nourriture les chevaux de leurs officiers. Ce fut au milieu de ces circonstances douloureuses que l’énergie et la bravoure de Paqueron lui valurent, à vingt-deux ans, les épaulettes de capitaine.
A cette brillante récompense de ses efforts Paqueron répondit par un redoublement d’énergie; et quand, le 2 janvier 1814, par un froid de 21 degrés, à cinq heures du matin, l’héroïque garnison de Dantzig dut prendre la route de l’exil, le jeune capitaine ou il fit à ses camarades et à ses soldats l’exemple vivifiant d’une patience et d’une sérénité d’âme qui releva les courages et repoussa le désespoir.
Cependant ses forces n‘étaient pas toujours à la hauteur de son énergie: une attaque de typhus faillit l’enlever et le réduisit à un état de maigreur qui le rendait méconnaissable, quand, le 30 septembre, il franchit le Rhin pour revoir son foyer d’Ancerville dévasté par le passage des armées ennemies. Cependant, le 19 août 1815, le jeune capitaine fut rappelé sous les drapeaux et envoyé au Havre pour travailler à l’armement de la place. L’ère des batailles était close. Qu’était-ce que cela pour un homme qui n’avait au cœur que deux pensées: Dieu et la patrie!
2 - SES PREMIERS MALHEURS
L‘aurore de la gloire militaire avait eu pour Paqueron toutes ces douceurs dont Vauvenargues conservait le souvenir et le regret; cette aurore ne connut pas de lendemain. Pendant trente-cinq ans, le brillant officier fut enfoui dans les travaux ingrats de l’artillerie et du service des poudres. A cette obscurité sans retour vinrent se joindre les coups redoublés de la douleur. Ce sont ces années stériles pour la gloire du monde, qui furent les plus riches et les plus fécondes pour cette vertu chrétienne qui a fait au vieux soldat une auréole impérissable.
Ce que voit le monde, c’est que, à l’éclat de ses débuts militaires, le génie souple et vivace de Paqueron substitue le mérite sérieux d’un administrateur intègre, d’un savant ingénieux, d’un officier tout entier aux devoirs de sa profession. Pour Dieu et pour la religion, Paqueron donna le plus noble témoignage d’une énergie morale qui ne laisse pas même voir ses efforts; car, la mort dans l'âme, il resta debout et ardent à sa tâche de chaque jour, attendant que Dieu le relevât de son poste.
C'est le 6 décembre 1816, qu’avec sa nomination d’inspecteur à la poudrerie de Saint-Jean-d’Angely, Paqueron, âgé de vingt-cinq ans, reçut la direction définitive de sa vie et entra dans la carrière Où il devait vivre et mourir. Ses vertus trouvèrent le moyen de s’y déployer; avec que! éclat, nous allons le voir.
La première occasion de montrer l’héroïsme de sa charité lui fut offerte le 25 mai 1818. La ville de Saint Jean-d’Angely était épouvantée par un violent incendie qui s’était produit après l'explosion de la poudrerie. D’une minute à l’autre on attendait des explosions nouvelles qui pouvaient faire sauter la ville: la terreur paralysait tous les courages. Seul le jeune inspecteur monte sur le toit du magasin à poudre que la flamme gagnait; seul, sur le volcan, avec un inaltérable sang-froid il poursuit toutes les étincelles, toutes les flammèches, couvre de linges mouillés des barils qui contenaient 1,500 kilogrammes de poudre, et sauve ainsi la ville d’un désastre épouvantable.

La ville de Saint Jean-d’Angely
Appelé aux fonctions de directeur des poudres et salpêtres à Paris, il eut à peine le temps d'y établir la femme que le ciel lui avait fait rencontrer, comme la digue compagne de sa vie, lorsqu’il fut frappé presque en même temps dans ses deux familles: c’est la loi; en étendant nos relations et nos joies, nous étendons et multiplions les prises offertes à la douleur. Une des plus cruelles épreuves fut celle qui, après six années d’union bénie par le ciel, enleva sa compagne a ce père de famille de trente-quatre ans. Les termes dans lesquels il exprime sa pieuse résignation méritent d’être conservés: « Combien de coeurs, 0 mon Dieu, vous demandaient alors la conservation de cette admirable femme! Vous n’avez point jugé dans votre sagesse infinie devoir exaucer nos prières; vous savez mieux que nous ce qui nous est nécessaire, et puisque toute votre conduite sur les hommes ne tend qu’à les rendre meilleurs, ne dois -je pas, malgré mes douleurs, vous remercier de votre conduite envers moi? »
Un ami donnait l'explication de cette résignation héroïque, en lui écrivant le 7 octobre 1825: « Votre foi vous a soutenu, et vous trouvez la paix où d’autres n’auraient trouvé que le désespoir... Combien la religion éleva l’âme au-dessus d’elle-même! »
Cinq mois après, Dieu lui enlevait encore son père, et, suivant l'expression de son ami, « c’était un consolateur visible de moins, mais une force réelle de plus, un nouveau protecteur dans le ciel. »
Après la mort de son père, Paqueron n’eut plus qu’un désir, réunir sa jeune famille à la famille de sa femme et rejoindre son beau-père à Angoulême. Quand il eut ainsi perdu tous les compagnons de sa vie et la plus intime confidente de ses pensées, Paqueron chercha à combler cet irréparable vide, en fixant dans un journal de sa vie les images de sa mémoire, les tristesses poignantes de son cœur et les aspirations généreuses de son existence nouvelle. C’est à partir de ce jour que Dieu prit la plus large place dans une vie consacrée à toutes les pratiques de la perfection chrétienne.
III
SON JOURNAL
Le journal de Paqueron est un monologue sincère de près de quarante ans; c'est une discussion de ses pensées et de ses sentiments, dont la sévérité même révèle, à son insu, toutes les délicatesses de cette grande âme. Il dit en commençant : « Que faire seul, le soir, dans cette chambre où je vois toujours un cercueil?... Des images funèbres peuplent ma solitude; mon cœur est plein de tempêtes... Je n'ai plus sur terre d’autres confidents que ce morne papier. »
Le spectacle de cette noble existence, la lecture de ces généreuses pensées est un aliment sain et fortifiant pour l’âme. Voici quelques extraits de son journal :
« L’essentiel, ici-bas, n’est pas d’avoir une existence agréable, mais de rendre son existence utile. Celui qui ne sait pas mettre à profit son temps et ses forces pour se rendre meilleur et faire du bien à ceux qui l’entourent, est complètement indigne de vivre. Un admirable moyen de se rendre chaque jour meilleur, c’est de scruter avec soin sa conscience et de juger impitoyablement par écrit ses actions quotidiennes. Rien n’est plus efficace que cette pratique; elle ramène et fixe la pensée toujours errante, elle développe le sens moral, elle met l'âme en possession de ses forces, et lui rend cette paix intérieure qui est préférable à tous les biens. »
« Il est nécessaire, en outre, de récapituler les observations des semaines, des mois et des années, pour constater les profits et les pertes, pour démêler les influences bonnes et mauvaises qui agissent sur nous et nous modifient sans cesse, et souvent à notre insu. Qu’il faut d’énergie et d'opiniâtre attention pour arriver simplement à connaître ce qui se passe en nous! »
D’ailleurs, ce n’était point un songe creux celui qui écrivait : « Dans la vie, tout ce qui ne passe pas en acte est perdu. »
En effet, toute l’énergie d’une grande âme éclate dans sa règle de conduite : « Qui ne sait pas être esclave de son devoir, ne sera jamais maître de ses passions: on ne règne d’un côté qu’en servant de l’autre. »
De même, son ardeur pour le travail trouve des expressions d’une heureuse énergie : «Il faudrait faire entrer mille ans dans chaque année, pour utiliser vraiment la vie et réaliser quelque chose qui demeure : Laboremus, labonmus! »
Religieux volontaire, il se trace un règlement, et son emploi de la journée offre le guide le plus édifiant :
« A cinq heures, je me lève et je prie Dieu, c’est ma force. Je lis ensuite une heure dans la Bible de Vence; vers sept heures, j’habille Charles et je le fais prier. Je donne une heure à mes correspondances officielles, une demi-heure ensuite à l’écriture de Charles, et de neuf heures et demie à onze heures et demie, j’expédie toutes les affaires de bureau. Durant ce temps, Charles travaille; je le fais réciter de onze heures et demie à midi; puis nous dînons ensemble. De midi à une heure et demie, récréation au jardin. Immédiatement après, je donne une nouvelle leçon à Charles, et de deux heures et demie à six heures du soir je suis livré à mes devoirs de surveillance et aux travaux actifs de ma vie officielle. Vient le souper, suivi d’une demi-heure de promenade avec mon fils. Nous rentrons; nous prions Dieu ensemble. Charles se couche; et de huit heures à dix heures je lis quelque ouvrage sérieux dont je fais l’analyse par écrit. Je termine ma journée par deux chapitres de l’Évangile, et je m’endors dans mes souvenirs de Nazareth ou du Calvaire, sans avoir senti trop lourdement le poids de ma pauvre vie. » (16 octobre 1825.)
Au sentiment profond de ses devoirs il joint une touchante modestie : « M‘instruire de plus en plus de mes devoirs et m’appliquer à les bien remplir, voilà toute la réalité sérieuse de la vie..... le sommaire de mes devoirs. ——Y en a-t-il un seul que je puisse me flatter d’avoir bien rempli? Qui dira toutes les défaillances de ma volonté et toute la fragilité de mes résolutions! »
Mais Dieu est son soutien: « Quelle force me donne cette conviction de la présence de Dieu! Malheur à l’homme qui vit seul et qui ne sent pas près de lui cet adorable voisinage l Que peut-il faire dans son isolement et quelle puissance terrestre est capable de relever son cœur? Moi, Seigneur, je sens bien que je ne suis fort qu’avec vous et en vous..... Soyez près de mon âme, Seigneur; et que je sente votre main et vos yeux sur moi»
Écoutez ces touchantes invectives d‘une âme rigoureuse pour elle-même jusqu’au scrupule : « Me voilà bien tel que je suis avec mes ridicules prétextes et mes éternels raisonnements! Je prétends que je suis trop occupé; mais le suis-je trop pour me promener chaque jour pendant une heure ou pour vaquer à ce qui plaît à ma nature? Est-ce que le temps qu’on donne à Dieu est perdu pour les devoirs officiels? Autant vaudrait soutenir que le temps des repas est perdu pour la vie physique. Prier Dieu, c'est prendre des forces pour tous les devoirs qu’on doit accomplir. »
« Mon vrai bonheur à l’avenir n’est que dans le bien que je puis faire autour de moi, à mes enfants, à mes proches, à mon pays. »
Tel était l’objet de son étude incessante et de son généreux labeur: « Ce n’est point l’augmentation de la fortune qu’il faut chercher dans le travail, cela le rabaisserait singulièrement. Ce qu’il y faut chercher avant tout, c’est l’accomplissement d’une loi positive de Dieu; c’est surtout l’expiation de nos fautes. Quiconque ne voit pas l’activité humaine de ce point de vue est incapable de la comprendre et incapable de l'honorer. »
Que de leçons proposées avec une précision heureuse et qui réunissent toutes les qualités : raison, sentiment, style : « Pour exclure le vague de ses pensées et empêcher l’inutile évaporation de son temps », aucun sacrifice ne lui coûte. Fidèle à cette rude prescription de Saint-Cyran:
« Défiez-Vous de vos larmes », il fait la part très étroite aux exigences légitimes de ses regrets.
Ma douleur, qui chaque jour grandit au lieu de s’apaiser, dévorerait stérilement ma vie, si je ne résistais à ses étreintes. Rien ne peut me défendre contre elle, comme la puissance des règles. Il faut que j’attache ma nature par des liens de fer et que je l’enferme dans d’inflexibles pratiques : si les idées et les principes clairs agissent singulièrement sur la conduite des hommes, il est également vrai que la conduite réagit à son tour très puissamment sur leurs idées et sur leurs sentiments; c’est ce que nous ne savons pas assez.
Bien vivre fait infailliblement bien penser et noblement sentir : soyons fermes sur les pratiques.
Il se reprochait un jour d’avoir rêvé d’accroître sa richesse par une spéculation commerciale: « Telle est la misère de l’homme qu’il se laisse séduire par des objets qui ne peuvent rien pour son bonheur. Qu’est-ce que peut tout l’or du monde pour la joie véritable de notre âme? Un grand élément de bonheur, c’est une bonne conscience délivrée de fautes et qui tient sous le joug toutes les passions : voilà le trésor qu’il faut ambitionner. »
Sa science, égale à sa modestie, lui donnait le droit de dire aux savants : « La lumière suit l’abnégation et l'humilité ; elle monte en baisse avec elles, et le meilleur moyen
de devenir savant c’est de devenir pieux» le Seigneur a dit : « La vérité est cachée aux superbes; mais elle est révélée aux petits. »
« L’aveu franc et sincère de notre ignorance est bien préférable pour nous et plus honorable aux yeux des hommes qu’un caquetage continuel qui ne sert qu’à montrer notre vide et à nourrir notre vanité.»
IV
SA VOCATION RELIGIEUSE
Enfin, au commencement de l’année 1829, appelé à l’inspection d’Angoulême, Paqueron eut hâte de quitter cette ville de Marseille Où il avait rendu tant de services,
mais où il avait tant pleuré.
Alors, à l'âge de trente-huit ans, commence pour lui une existence nouvelle; elle s’élargit, s'étend et se complique de ses devoirs de père de famille et des obligations d’une mission qui se révèle à lui d‘une façon plus vive que jamais; il écrit: « 0 mon Dieu! prenez dans ma vie la place de mes chers absents; prenez le temps, prenez les forces que je leur aurais consacrés. Plus vous m’avez été, plus je veux vous donner, afin de retrouver en vous tout ce que j’ai perdu. ».....
« Je n’aurais pas cru pouvoir m’oublier ainsi; les semaines et les mois s’évaporent comme si j’étais heureux. «Qui sait même si je ne le suis pas? C’est Joubert, je crois, qui a dit : « On n’est guère malheureux que par la réflexion. » Et de vrai, quand j‘évoque le passé, je sens un vide affreux; mais quand je m’enferme dans le présent, quand je regarde près de moi le front pur de mes enfants, et là-haut, sur leur colline, ces vieilles églises.
Lorsqu’il est envoyé en Algérie, sur la terre d’Afrique, tous les faits sont, pour cet esprit pénétrant, pour cette âme généreuse, des occasions d’étude et de réflexion. Il a le talent de la description poétique tout comme tant d’autres talents, et sa piété donne à ses descriptions un éclat plus touchant et plus vif :
«Je n’oublierai jamais ma journée d’Hippone. Je m’attendais à un pays désert, j’ai trouvé la plus florissante vallée du monde, un bassin plein de soleil, d’aubépines séculaires, de vertes prairies, de blés jaunissants au pied de l’Atlas et en face de la Méditerranée, magnifique Éden où la Providence avait placé le plus grand des hommes nouveaux ( St-Augustin) après saint Paul! Voilà le point d’où ce flambeau a rayonné sur le monde. Je questionne les Maures que je rencontre ; ils ont gardé parfaitement le souvenir du grand chrétien, Roumi Ke’bir, qui glorifia ce rivage, et ils l’invoquent comme un puissant ami de Dieu. »

Hippone en Algérie actuelle - L`endroit ou vivait au temps de l`empire romain St-Augustin - ce grand docteur de l`Église
C’est à Hippone qu’il formule ces principes d'une haute philosophie de l'histoire :
« Quelle démonstration catholique je vois et je touche ici! Il y a eu sur ces rivages une admirable civilisation, une prospérité matérielle et morale créées et soutenues pendant des siècles par le christianisme ; dès que Mahomet a pris la place de Jésus-Christ, la barbarie est venue, et mes yeux la contemplent : où l’Église avait fait la vie, l’Islam fait la mort. Qu’on dise donc que les doctrines sont indifférentes, et que les gouvernements peuvent sans danger se détacher de l’Église. Tout est dans les doctrines, dans les religions surtout : la question religieuse est une question de vie ou de mort, plus visiblement peut-être encore pour les nations que pour les individus. »
A la suite d’études, de voyages, de travaux et de recherches poursuivis en Afrique avec une ardeur infatigable, au lieu de réclamer une récompense, Paqueron se trouve. très heureux de rentrer à la poudrerie d'Angoulème : « Me voici rendu à mes ouvriers et à mes poudres: j’ai mon foyer rétabli, j’ai ma fille près de moi que je garde et qui me garde..... Je mets Dieu dans mes travaux. Que me fait tout le reste du monde ? Notre-Seigneur colore et poétise jusqu’à mes labeurs vulgaires. Que le bon Dieu est bon!»
Son détachement des biens du monde était absolu et sincère : «Je ne veux de la terre, que tout juste ce qu’il en faut pour aller au ciel..... L’avancement viendra quand Dieu voudra, et quant à la gloire, j‘ai la mienne la, dans le témoignage de ma conscience. »
Aussi son inaltérable bonne humeur trouvait des mots charmants. Relevé comme mort, à la suite d’une chute sur la tête, il disait en revenant à la vie : « Le bon Dieu ne m’a pas trouvé mûr pour l’éternité. »
Mais l’humilité chrétienne et l’indépendance de caractère ne sont pas des recommandations qui aient cours auprès des gouvernements modernes; malgré ses services exceptionnels, ce ne fut qu’à cinquante-quatre ans que le brillant capitaine de Dantzig fut nommé lieutenant-colonel, et il attendit vingt-huit-ans la rosette d’officier de la Légion d’honneur. « C’est bien un peu long, disait-il; mais il y a beaucoup de ma faute. J’aurais dû (si j’avais pu!) me conformer à l’usage commun, et manifester au moins un désir; j'aurais aujourd’hui dix ans de grade. »
Comme sa sincérité religieuse était au-dessus de tout respect humain, Paqueron eut le droit de conseiller la même vertu a son fils. Lorsqu’en 1839, Charles fut reçu à.
l’École polytechnique, où les sentiments religieux étaient assez mal vus, Paqueron écrivit à son fils : « Arbore ton drapeau tout de suite, afin que l’on sache qui tu es. Il faut qu’après quarante-huit heures, aucun de tes camarades n’ait un doute à ton sujet. C’est l’unique moyen d‘éviter les positions fausses et les engagements équivoques. Sois chrétien simplement, mais franchement. Parler comme on croit et agir comme on parle, voilà la meilleure logique du monde et celle qui produit toujours grand effet. Pas de faiblesse surtout! Quand on a l’honneur d’être chrétien, il ne s’agit pas de se, faire pardonner ou tolérer; mais bien de se faire respecter. N’aie pas peur de passer pour singulier. Voici plus de quarante ans que, pour ma part, je suis très singulier, et ni Dieu ni les hommes ne m’en ont encore puni. »
Tous les instituteurs de l’enfance devraient avoir présente à l’esprit cette belle parole : « Dieu a mis dans l’âme des enfants l’obéissance et la pureté; malheur a qui leur fait perdre l’un ou l’autre! il tue sans remède l’homme dans l’enfant. »
Comme la piété simplifie et élève les principes de l’éducation : «: Il me semble que mes devoirs de père se réduisent tous a un seul: défendre les intérêts de Dieu dans le coeur de mon fils. C’est protéger d’un seul coup et sauver à la fois les droits de mon fils et mes propres droits de père : tout est harmonie dans le bien.»
Aussi, que de bon sens dans ces conseils à son jeune élève de l’École : « Sois bon camarade, de relations faciles, d’esprit large, et travaille en conscience pour remplir les vues de Dieu, préparer ton avenir et servir utilement ton pays. De la science, de la gaieté, de l'amitié franche, mais pas de politique dans les conversations ; tu feras de la politique plus tard; l’art de déraisonner ne passera pas sitôt de mode. »
Sa règle de conduite étant bien simple, il la conseille à son fils : « Dans tes luttes, il n’y a pas à hésiter : prends toujours le parti de Dieu contre toi-même, aussi bien que contre les autres. C’est le seul parti de l’honneur et de la victoire. C’est aussi le seul parti de ton père, tu me trouveras toujours de ce côté. »
La plus éloquente des leçons est la leçon de l’exemple; avec quelle franchise le père la donne à son fils : « Ne te décourage pas, mon cher et bon Charles; Dieu ne demande pas le succès, mais le travail plein d’ardeur et d'opiniâtreté. J’ai eu comme toi mes lassitudes et mes dégoûts; j’ai triomphé de tout par la patience et par une imperturbable confiance en Dieu. Je me suis toujours dit: « Si je travaille bien, avec des intentions droites, Dieu me bénira; il ne pourra pas s’y refuser; et, dans cette conviction, j’ai trouvé sans cesse du courage plein mon coeur. Mets simplement le bon Dieu en mesure de s’exécuter, et tu verras! C’est encore la politique de ma barbe grise. »
La justesse et la force de l'expression répondent à l’élévation de la pensée, quand il dit avec l'énergie d’un Pascal: « Soyons logiques toujours, et allons bravement jusqu'au bout. Pas d’à peu près, surtout en fait de dogmes et de morale... Les demi-vérités, les demi-croyances, les demi dévouements, bagage des âmes peu formées qui appellent modération ce qui n’est que lâcheté ou impuissance. »
Voilà en quelques lignes un traité de pédagogie morale qu’on aurait quelque peine à remplacer par les platitudes de la libre-pensée.
Sur l’alliance entre la science et la foi, en ne peut mieux dire ni avec un esprit plus piquant lorqu‘on est élève de l’École polytechnique : « Les mathématiques, qui forment le jugement pour l'ordre abstrait, le déforment souvent et le faussent pour l’ordre moral. Il y a autre chose à faire ici-bas que des ponts et des digues; tel habile ingénieur capable des plus beaux travaux peut n‘être qu’un imbécile dans la vie pratique. Étudions les mathématiques pour l’utilité sociale; mais étudions en même temps la religion pour l’utilité personnelle. La science abstraite ne répond qu’à quelques-uns des besoins intellectuels de l’homme; la religion répond à toutes ses aspirations. Le savant sans religion n’est qu’un animal perfectionné, espèce fort dangereuse; le chrétien même ignorant est un homme civilisé, agréable à Dieu, utile à ses frères et fort commode aux gouvernements.»
Nul moraliste n’a mieux senti et mieux rendu l’harmonie profonde qui unit le bonheur au devoir : « Quel est l’attrait qui manque au devoir? Cherchons-nous le bonheur? il y est. Le progrès de l’âme? il y est. La vraie gloire? on l’y trouve. Dieu lui-même enfin? il y est aussi, et il nous y attend, comme caché au fond, car tout devoir accompli mène à Dieu. »
Sur la piété, ni saint François ni sainte Thérèse n’auraient pu rencontrer un développement plus éloquent:
« La piété est un amour de Dieu poussé jusqu’à l’enivrement et à la béatitude intérieure. Ne pas arriver jusque-là dans la vie chrétienne, c’est n’arriver à rien du tout. Est-ce que Dieu n’est pas descendu pour nous jusqu’à la folie de la Croix ? Oui certes. La seule mesure de l’aimer après cela, c’est de l’aimer sans mesure. »
Une sorte de splendeur mystique illumine certaines de ses lettres à son fils :
« Nous sommes allés à la sainte table ensemble ta sœur et moi ; c'était le dix-neuvième anniversaire de la mort de ta mère. Je ne sais ce qui s’est passé ; mais mon émotion, les grâces de Dieu, les souvenirs d’autrefois, tout s’est mêlé et confondu dans une abondance de vie, dans une intensité de joie que je ne saurais jamais dire. J’ai eu comme l'avant-goût du ciel. Quel admirable mystère que la sainte Eucharistie l Je ne comprends pas, mais je sens et je suis heureux. »
La pensée de la mort étant toujours présente à son cœur, tous les accidents qui frappaient autour de lui devenaient autant de leçons : «Qu’importe la différence d’âge? Disait-il; la Providence ne m’a pas signé de bail. Soyons prêts à toute heure ; c’est la vraie sagesse de la vie présente. »
Pour s'encourager à donner beaucoup, il se répétait une formule pittoresque qu’une pauvre vieille lui avait dite comme remerciement: « Ce qu’on mange pourrit, ce qu’on
donne fleurit! »
Moraliste chrétien, Paqueron flagelle de coups impitoyables notre vaniteuse faiblesse; il veut mettre son fils à l’abri de cette irritabilité nerveuse qui conduit à l’imbécillité :
« Du calme et une ferme confiance en Dieu. Défendons nous des impressions de chaque heure ; l'impressionnabilité est une maladie de ce temps, elle ruine la vie morale qui a besoin de fixité et d’appuis permanents.»
« Nos pères étaient forts et résistants par l’âme, parce qu’ils avaient moins d’idées flottantes que nous et plus de croyances, moins de sentiments vifs et plus de sentiments constants. Leur vie était appuyée à d’immuables principes, attachée et vouée à d’éternelles beautés; les coups de vent de la fortune privée ou des événements publics passaient sur elle sans l’ébranler. Je puis tout en celui qui me fortifie telle était sa devise.»
« Aujourd'hui, détachés de Dieu et réduits à nos propres misères, nous sommes en même temps vains et peureux; nous commençons fastueusement et nous finissons misérablement. Le moindre souffle nous renverse et nous emporte. C’est pitié de nous voir rouler dans un tourbillon d’impressions et d’idées changeantes, aspirant à nous accrocher à tout et ne nous fixant à rien, passionnés, dirait-on, pour tout, et pourtant n’aimant rien, vieux enfants, sans l’innocence du jeune âge, sans la sagesse des vieillards. »
«Soyons plus forts que ce temps et ne séparons notre cœur ni de nos dogmes, ni de nos espérances, ni de nos devoirs : ce sont les trois grandes attaches de la vie. »
Il faut voir avec quelle pénétration admirable il devine en 1849 les périls du voltairianisme et de l’irréligion
« Les tendances de l’enseignement public, celles du Collège de France en particulier, me jettent dans l’épouvante. On rit niaisement des doctrines modernes; autant vaudrait rire de la foudre, quand elle gronde et qu’elle est près d’écraser le navire. Ces leçons de philosophie, tout émaillées de traits d’esprit décochés contre les catholiques, sont des sacs de poudre placés en plein jour sous les murs de l’Europe. On n’y prend pas garde aujourd'hui ; on sautera en l’air demain. »
Jamais la misère morale de notre temps n’a tiré d’une âme chrétienne une plainte plus sincère et plus touchante. C’est le cœur de Fénelon qui parle la langue de Joseph
de Maistre :
« Rien n’est plus triste que l’état de ces maisons déchues où le superflu reste quand le nécessaire est parti. Le contraste entre ce qui survit du luxe ancien et les tortures de la misère présente est horriblement douloureux. On dirait une dérision de la fortune d’hier insultant au malheur d’aujourd’hui. C’est l’état de ce siècle où le superflu abonde; mais où le nécessaire manque. Dés sciences, des arts, de l’industrie, une grande civilisation au dehors ; et pas de principes, pas de bon sens au dedans. De la littérature et point de vérités; des bijoux et pas de pain. Que de fripiers qui jouent au millionnaire avec de vieilles loques! Triste, triste! De la science, oui; de l’art, oui; du commerce, oui; je veux bien de tout cela; mais, avec tout cela, j‘ai faim, et je veux le pain de vie. Vieux enfants, sans l’innocence du jeune âge sans la sagesse des vieillards. »
La société contemporaine est tout entière dans ces traits d’une vérité désolante.
Après le mariage de sa fille, Paqueron, promu au grade de lieutenant-colonel, fut appelé, en 1846, à la direction de la capsulerie de guerre à Paris. Plein de sécurité pour l’avenir de ses deux enfants, il ne vit dans cet avancement qu’un nouveau moyen de donner à Dieu tout ce qui lui restait de forces.
Il semblait en vérité qu’il prit pour devise et règle de conduite le mot d’un moraliste : « Toute vie à sa grandeur, et comme il t‘est impossible de sortir de Dieu, le mieux est d’y élire sciemment domicile. »
Quelques mois après sur la proposition spontanée de S. A. R. le duc de Montpensier, président de la Commission pour l'étude du pyroxyle ou poudre-coton, Paqueron fut nommé colonel, à l'âge de cinquante-six ans. D’ailleurs rien n’était changé dans sa vie, où la religion occupait dès longtemps la première place. Uni de cœur et de croyance aux membres de la société catholique de Paris, il en admirait les vertus et il écrivait à ses enfants : « Si toute la bourgeoisie française était animée du même souffle, la France serait sauvée.»
Malgré l’ardeur de son dévouement, il ne se dissimulait pas la nécessité d’un secours de Dieu : «La science orgueilleuse n’aboutira jamais à rien pour le salut du monde. L’avenir appartient aux humbles de cœur. Celui qui se fait petit devant Dieu, qui prie en secret, qui communie pour les pauvres, est plus utile à la société que les plus beaux philanthropes du monde. »
Il sentait que rien n’est petit pour les grandes âmes, et que la charité ennoblit tous les travaux. Pendant deux ans, à Paris, il s'occupa seul de ce qu’il appelait l’Œuvre des Souliers, recueillant lui-même les vieilles chaussures, les faisant réparer, les nettoyant de ses mains et les portant ensuite à ses pauvres. « J’en ai quelquefois jusqu’à douze et quinze cents paires sur mes planches, disait-il en riant, et je frotte, je frotte! »
D’ailleurs, voici comment il profitait des amusements de Paris. Un officier général de ses amis le priant de l’accompagner au théâtre : «Volontiers, dit le colonel ;mais ayez seulement la complaisance de venir avec moi dans une maison où j’ai affaire pour quelques minutes. »
Et il conduisit son ami dans un misérable réduit de la rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, où une mère et cinq enfants pleuraient près du lit d’un père malade depuis longtemps.
La scène était navrante. « Si nous laissions ici l’argent du spectacle? dit Paqueron dans l’oreille de son ami. Allons! dit celui-ci, allons! c’est un traquenard de votre façon; inutile d’essayer d’en retirer la patte! » Et il lui remit trois pièces d’or dans la main.
Dans les moments trop douloureux de la vie, pour soutenir sa résolution, à ses prières il joignait des sacrifices de charité.
Témoin ému de la révolution du 24 février 1848, il en mesura toute la profondeur avec une sagacité dont bien peu d’homme politiques furent capables :
« La houle est enfin tombée; mais dans la rue seulement nous avons de l’orage pour longtemps dans les âmes... La Révolution cette fois n’a rien profané, c’est vrai; elle n’a peut-être pas cassé les vitres d’un seul presbytère de village; mais il ne faudrait pas s’y méprendre pourtant, elle n’en est pas moins l’antichristianisme vivant. Elle ne met pas la main sur les prêtres ; mais elle menace de renverser de fond en comble l‘ordre religieux... C’est peut-être la plus large attaque doctrinale contre l’Église qu’il y ait eu depuis Notre-Seigneur. Quelle est la question cachée dans les vapeurs de cet orage? Si je ne me trompe, c’est celle-ci : « Ne pouvons-nous pas, ne devons-nous pas faire notre bonheur sur la terre, en dehors des solutions chrétiennes et des formes sociales inspirées jusqu’à présent par elles? » Ce n'est point une question politique, c’est tout simplement une question théologique, et cette question jetée dans les débats publics de ce temps, c'est du fulminate de mercure disséminé dans l’air. J’ai bien peur pour l’avenir. »
Quand, aujourd’hui, nous rapprochons ces pronostics du cri féroce et stupide « le cléricalisme c'est l’ennemi »; quand nous assistons aux persécutions qui l’ont suivi; comment ne pas reconnaître que Paqueron avait vu très juste et que les vingt années du second Empire n’ont été qu’un temps d’arrêt dans la marche de la Révolution, c’est-à-dire dans la ruine de la France ?
MichelT- Date d'inscription : 06/02/2010
 Re: Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron
Re: Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron
Une circonstance imprévue et touchante lui donna même un rôle dans un des drames sanglants de la révolution de 1818. Le récit en a été laissé par un témoin dont la déposition est pleine d’intérêt : Pendant la sédition du mois de juin, le colonel, cerné par les émeutiers du faubourg Saint-Antoine, vit paraître a la capsulerie Monseigneur Affre, archevêque de Paris, qui, avant d’aller tenter une mission de pacification, avait voulu conférer quelques instants avec celui dont il connaissait et appréciait la piété, l’expérience et le jugement. Le colonel se jeta aux pieds du bon pasteur, se confondit en admiration pour son dévouement; mais ne lui cacha pas ses terreurs. «Ils sont ivres, Monseigneur, disait-il.—Eh! bien, s’ils me tuent, ils seront moins coupables; allons! » —
M. Paqueron demanda à embrasser le martyr, et coupant dans son jardin un grand rameau vert qu’il lui remit entre les mains: «Dieu vous donne de me le rapporter bientôt, » lui dit-il. Vingt minutes après, Monseigneur était sur la place de la Bastille et le sacrifice était consommé. L’archevêque de Paris était tombé en disant : « Le bon pasteur donne sa vie pour son troupeau. »
L'âme déchirée de regrets et de désespoir, le colonel renonça à tout rêve de vie en famille à Paris, et quelques jours après, il accueillit, comme une délivrance, son envoi a la Rochelle avec le titre de directeur d'artillerie. Les quatre années qu'il passa dans ce poste furent une longue fête pour lui. Même les protestants le recherchaient avec une sympathie respectueuse: ( Ah! disaient—ils, si tous les catholiques étaient comme lui, demain nous serions tous catholiques. »
Aussi l'évêque de la Rochelle disait-il de son cher colonel : « Il a autre chose à son service qu’une artillerie de bronze ; il vous braque de tous côtés des vertus capables de confondre nos plus mortels adversaires. » En effet, le colonel répétait : « Ne discutons pas; mais vivons bien.»
La lumière des œuvres éclaire tout le monde et ne froisse personne. Quand la soixantième année vint, comme il le dit: sonner « le coup de clairon de la dernière campagne, » le vieux soldat entra joyeux et dispos dans une vie nouvelle.
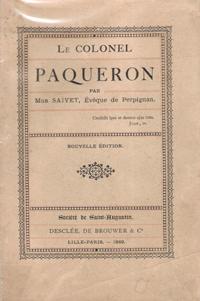
A l’archevêque qui lui demandait : « Qu’allez-vous devenir, colonel, avec votre ardeur et votre plénitude de vie? » Il répondait simplement: « Je quitte le service militaire, Monseigneur ; mais je passe tout de suite au service de Dieu. »
Ainsi pour les natures d’élite, la vieillesse, au lieu d’être une décadence, est l’épanouissement de toutes les puissances de la vie : « Ce n’est pas vers la fin du combat qu’on se relâche, disait le colonel retiré à Angoulême, c’est alors au contraire qu’il faut frapper les plus grands coups. »
A la même époque, il disait encore : « J’ai longtemps servi Dieu avec le seul désir de l’aimer beaucoup, mais sans rien éprouver de sensible en mon âme. Aujourd’hui je sans Dieu très réellement dans mon cœur, j’en jouis d’une façon indicible et presque à toute heure. »
Quelles paroles ! Nul saint peut-être n’a rendu en termes plus expressifs la présence de la grâce dans une âme chrétienne. Pendant onze années, il se multiplie d’une façon si généreuse et si active pour l’État, pour la ville, pour l'Église, pour les pauvres, pour les malades, qu’un ami disait avec admiration : « Je ne me figure pas Angoulême sans lui. »
La même discipline rigoureuse qu’il avait imposée à sa jeunesse, il en reporte l’habitude dans ses dernières journées de travail : le commencement et la fin du jour étaient consacrés à son âme et à Dieu; le reste du temps se partageait entre la famille et les œuvres chrétiennes. Sa règle de conduite était : « Dieu me déposera quand il voudra; mais je n’abdiquerai pas. » Aussi son autorité affectueuse était souveraine sur ses petits-enfants auxquels il apprenait, avec une fermeté tendre, à conserver les deux trésors de leur âge : « Dieu a mis deux perles dans l’âme des enfants, l'obéissance et la pureté; malheur à qui leur fait perdre l’une ou l’autre! il tue l’homme dans l’enfant...»
Qui veut élever des enfants doit d’abord devenir un saint. Comment faire passer en eux des vertus qu’on n’a pas soi-même? Devenons des saints, de vrais saints; sans cela, nous ne serons jamais que de mauvais pères.
Modeste ouvrier de Dieu, il ne renia jamais son maître : « Faire une association de pure philanthropie où Dieu n’entrerait pour rien, je trouve que ce serait folie d’y perdre mon temps. Où Notre-Seigneur n’est pas, j’étouffe. Il est pour nous la vie véritable, et je déclare que j’ai bonne envie de vivre.»
Aussi, quand il offre ses bons offices aux cinq cents ouvriers qui l’ont nommé président de leur Association de secours, il leur dit, en commentant le mot de saint Paul : « J’appartiens à tous, et mon ambition est de vous servir tous pour vous faire mieux servir Dieu. »
A Angoulême, comme à Paris et à la Rochelle, il fut un membre actif de la Société de Saint-Vincent-de-Paul dont il disait : « C’est l’œuvre providentielle du temps présent... C’est l’espérance suprême de l’avenir. Toute la jeunesse devrait y entrer. » Il y rencontra dans ses dernières années ce colonel Chitry qu’on voyait à quatre heures du matin attendant sur le seuil de la cathédrale que la porte lui fût ouverte: « Je suis le factionnaire du bon Dieu, disait—il, et mon devoir est d’attendre. »
Élu président de la Conférence, Paqueron en prit la direction avec le sentiment d’un grand ministère à remplir: « Si l’esprit de la Conférence venait à s’attiédir ou à se fausser entre mes mains! » Aussi en préparait-il chaque réunion avec un soin très attentif et une habileté très spirituelle, grâce à laquelle jamais rien de froid, de monotone ni de lourd.
Sur son agenda, ou cahier de notes intimes, on a pu relever mille témoignages de la pureté et de la grandeur de son âme :
« La femme B. inaccessible. S’informer des anniversaires de sa vie. Provoquer quelques fêtes de famille. Apporter de l’argent et du linge. »
« Les familles T. et F. ont besoin de beaucoup de grâces. Cœurs endurcis. Faire la sainte communion à leur intention; les accabler de prévenances, de bienfaits; étouffer l’ingratitude par l’amour. »
« Grande action de grâces à notre-Seigneur. Le père T. s’est converti, il s’est confessé ; il a fait ses pâques; il est heureux comme un ange.»
La même régularité, la même méthode qu’il portait dans les affaires, s’appliquait à ses dépenses de charité.
C’est à Angoulême qu’un administrateur public rendait hommage à son infatigable activité par un mot charmant sous sa forme familière : « On aurait bien tort de se gêner avec le colonel: il a dix hommes à son service en un seul. »
Mgr Cousseau le nommait plaisamment « son grand vicaire laïque ».
Une des plus grandes joies de sa vie, ce fut, à l’âge de plus de soixante-dix ans, son pèlerinage à Rome en 1862; il disait à propos de S. S. Pie IX :
« Il est malheureux; les nations catholiques l’abandonnent, les puissances le trahissent: double raison pour aller saluer son infortune et vénérer son grand cœur. Pie IX est à la fois père, prince et pontife. »
Partout et toujours l’injustice et l'impiété l’irritent; il les poursuit et les flagelle avec une énergie toujours jeune. Voici comment il raconte une aventure de son séjour à Rome :
«Imaginez que j’ai failli faire une scène l’autre jour dans une réunion d’officiers français. J’en suis encore confondu. Ces messieurs plaisantaient, et vous savez bien que je sais rire; mais ils ont eu la fantaisie de faire les beaux esprits, raillant le gouvernement pontifical, accusant la Cour romaine et le reste..... J’ai essayé de me
taire, puis j’ai éclaté. — « Messieurs, leur ai-je dit, vous êtes ici au nom de la France pour y protéger l’autorité du pape, et vous l’y détruisez. Ce que vous faites est une trahison! Un coup de tonnerre n’eût pas fait plus d’effet. Ils ont mordu leur moustache et gardé le silence. »
A la limite extrême de la vieillesse, quelle verdeur de sentiment, quelle puissance d’imagination dans ce jugement sur Rome :
« La religion, l’histoire, la nature, les arts forment ici une sorte de conjuration puissante pour s’emparer de l’âme tout entière, l’éblouir, l’écraser sous d’irrésistibles impressions. On en a pour des jours avant de se remettre et de reprendre possession de soi-même. Je ne suis pas encore assez maître de moi et de mes sentiments pour en jouir. Ces ruines m’accablent, ces catacombes me transportent, ces grandeurs chrétiennes m’exaltent, cette lumière de Rome m’enivre, et Pie IX, que j’ai vu et entendu, me poursuit et me fascine sans m’abandonner un seul instant. J’écrirai plus tard. »
Une année après, il rappela soudainement son serviteur en plein exercice de ses forces et dans l’accomplissement parfait de tous ses devoirs, le 28 décembre 1863. Paqueron disait quelques jours auparavant : « Tenons-nous prêt; c’est peut—être le moment où Dieu va frapper. » Ses derniers mots furent : « Jésusl... Marie ... les voir ! »
Tels sont les mérites les plus apparents de ce vrai chrétien. La Providence l’avait comblé de tous ses dons : âme vaillante, charmant esprit, philosophe profond, moraliste pénétrant, Paqueron a été bien supérieur à sa destinée en ce monde et admirablement préparé à sa destinée en Dieu.
Confiné dans les honneurs obscurs d’un régiment, Paqueron ne fit que traverser Paris, alors que, dans une de ses convulsions révolutionnaires, Paris s’agitant dans le sang et dans la boue, se déshonorait par un meurtre qui était une lâcheté. Maudissant a jamais la grande ville, Paqueron était allé s’enfermer de parti pris dans une petite ville de province. C'est de là qu’il aimait à contempler, de là qu’il montrait à tous la vraie grandeur d’un horizon digne de l’homme, l’horizon chrétien : le ciel où il aspirait.
Paqueron a brillé de toute la gloire du chrétien dans l’obscurité apparente d’une destinée médiocre.[Rapporter à Dieu tous ses sentiments, toutes ses pensées et tous ses actes, c’est le moyen infaillible de supporter la douleur avec résignation, de tirer de son intelligence tous les fruits qu’elle peut produire, de réaliser la plus grande somme de bien dont l’homme soit capable.
M. Paqueron demanda à embrasser le martyr, et coupant dans son jardin un grand rameau vert qu’il lui remit entre les mains: «Dieu vous donne de me le rapporter bientôt, » lui dit-il. Vingt minutes après, Monseigneur était sur la place de la Bastille et le sacrifice était consommé. L’archevêque de Paris était tombé en disant : « Le bon pasteur donne sa vie pour son troupeau. »
L'âme déchirée de regrets et de désespoir, le colonel renonça à tout rêve de vie en famille à Paris, et quelques jours après, il accueillit, comme une délivrance, son envoi a la Rochelle avec le titre de directeur d'artillerie. Les quatre années qu'il passa dans ce poste furent une longue fête pour lui. Même les protestants le recherchaient avec une sympathie respectueuse: ( Ah! disaient—ils, si tous les catholiques étaient comme lui, demain nous serions tous catholiques. »
Aussi l'évêque de la Rochelle disait-il de son cher colonel : « Il a autre chose à son service qu’une artillerie de bronze ; il vous braque de tous côtés des vertus capables de confondre nos plus mortels adversaires. » En effet, le colonel répétait : « Ne discutons pas; mais vivons bien.»
La lumière des œuvres éclaire tout le monde et ne froisse personne. Quand la soixantième année vint, comme il le dit: sonner « le coup de clairon de la dernière campagne, » le vieux soldat entra joyeux et dispos dans une vie nouvelle.
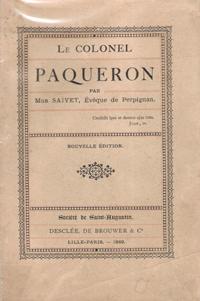
A l’archevêque qui lui demandait : « Qu’allez-vous devenir, colonel, avec votre ardeur et votre plénitude de vie? » Il répondait simplement: « Je quitte le service militaire, Monseigneur ; mais je passe tout de suite au service de Dieu. »
Ainsi pour les natures d’élite, la vieillesse, au lieu d’être une décadence, est l’épanouissement de toutes les puissances de la vie : « Ce n’est pas vers la fin du combat qu’on se relâche, disait le colonel retiré à Angoulême, c’est alors au contraire qu’il faut frapper les plus grands coups. »
A la même époque, il disait encore : « J’ai longtemps servi Dieu avec le seul désir de l’aimer beaucoup, mais sans rien éprouver de sensible en mon âme. Aujourd’hui je sans Dieu très réellement dans mon cœur, j’en jouis d’une façon indicible et presque à toute heure. »
Quelles paroles ! Nul saint peut-être n’a rendu en termes plus expressifs la présence de la grâce dans une âme chrétienne. Pendant onze années, il se multiplie d’une façon si généreuse et si active pour l’État, pour la ville, pour l'Église, pour les pauvres, pour les malades, qu’un ami disait avec admiration : « Je ne me figure pas Angoulême sans lui. »
La même discipline rigoureuse qu’il avait imposée à sa jeunesse, il en reporte l’habitude dans ses dernières journées de travail : le commencement et la fin du jour étaient consacrés à son âme et à Dieu; le reste du temps se partageait entre la famille et les œuvres chrétiennes. Sa règle de conduite était : « Dieu me déposera quand il voudra; mais je n’abdiquerai pas. » Aussi son autorité affectueuse était souveraine sur ses petits-enfants auxquels il apprenait, avec une fermeté tendre, à conserver les deux trésors de leur âge : « Dieu a mis deux perles dans l’âme des enfants, l'obéissance et la pureté; malheur à qui leur fait perdre l’une ou l’autre! il tue l’homme dans l’enfant...»
Qui veut élever des enfants doit d’abord devenir un saint. Comment faire passer en eux des vertus qu’on n’a pas soi-même? Devenons des saints, de vrais saints; sans cela, nous ne serons jamais que de mauvais pères.
Modeste ouvrier de Dieu, il ne renia jamais son maître : « Faire une association de pure philanthropie où Dieu n’entrerait pour rien, je trouve que ce serait folie d’y perdre mon temps. Où Notre-Seigneur n’est pas, j’étouffe. Il est pour nous la vie véritable, et je déclare que j’ai bonne envie de vivre.»
Aussi, quand il offre ses bons offices aux cinq cents ouvriers qui l’ont nommé président de leur Association de secours, il leur dit, en commentant le mot de saint Paul : « J’appartiens à tous, et mon ambition est de vous servir tous pour vous faire mieux servir Dieu. »
A Angoulême, comme à Paris et à la Rochelle, il fut un membre actif de la Société de Saint-Vincent-de-Paul dont il disait : « C’est l’œuvre providentielle du temps présent... C’est l’espérance suprême de l’avenir. Toute la jeunesse devrait y entrer. » Il y rencontra dans ses dernières années ce colonel Chitry qu’on voyait à quatre heures du matin attendant sur le seuil de la cathédrale que la porte lui fût ouverte: « Je suis le factionnaire du bon Dieu, disait—il, et mon devoir est d’attendre. »
Élu président de la Conférence, Paqueron en prit la direction avec le sentiment d’un grand ministère à remplir: « Si l’esprit de la Conférence venait à s’attiédir ou à se fausser entre mes mains! » Aussi en préparait-il chaque réunion avec un soin très attentif et une habileté très spirituelle, grâce à laquelle jamais rien de froid, de monotone ni de lourd.
Sur son agenda, ou cahier de notes intimes, on a pu relever mille témoignages de la pureté et de la grandeur de son âme :
« La femme B. inaccessible. S’informer des anniversaires de sa vie. Provoquer quelques fêtes de famille. Apporter de l’argent et du linge. »
« Les familles T. et F. ont besoin de beaucoup de grâces. Cœurs endurcis. Faire la sainte communion à leur intention; les accabler de prévenances, de bienfaits; étouffer l’ingratitude par l’amour. »
« Grande action de grâces à notre-Seigneur. Le père T. s’est converti, il s’est confessé ; il a fait ses pâques; il est heureux comme un ange.»
La même régularité, la même méthode qu’il portait dans les affaires, s’appliquait à ses dépenses de charité.
C’est à Angoulême qu’un administrateur public rendait hommage à son infatigable activité par un mot charmant sous sa forme familière : « On aurait bien tort de se gêner avec le colonel: il a dix hommes à son service en un seul. »
Mgr Cousseau le nommait plaisamment « son grand vicaire laïque ».
Une des plus grandes joies de sa vie, ce fut, à l’âge de plus de soixante-dix ans, son pèlerinage à Rome en 1862; il disait à propos de S. S. Pie IX :
« Il est malheureux; les nations catholiques l’abandonnent, les puissances le trahissent: double raison pour aller saluer son infortune et vénérer son grand cœur. Pie IX est à la fois père, prince et pontife. »
Partout et toujours l’injustice et l'impiété l’irritent; il les poursuit et les flagelle avec une énergie toujours jeune. Voici comment il raconte une aventure de son séjour à Rome :
«Imaginez que j’ai failli faire une scène l’autre jour dans une réunion d’officiers français. J’en suis encore confondu. Ces messieurs plaisantaient, et vous savez bien que je sais rire; mais ils ont eu la fantaisie de faire les beaux esprits, raillant le gouvernement pontifical, accusant la Cour romaine et le reste..... J’ai essayé de me
taire, puis j’ai éclaté. — « Messieurs, leur ai-je dit, vous êtes ici au nom de la France pour y protéger l’autorité du pape, et vous l’y détruisez. Ce que vous faites est une trahison! Un coup de tonnerre n’eût pas fait plus d’effet. Ils ont mordu leur moustache et gardé le silence. »
A la limite extrême de la vieillesse, quelle verdeur de sentiment, quelle puissance d’imagination dans ce jugement sur Rome :
« La religion, l’histoire, la nature, les arts forment ici une sorte de conjuration puissante pour s’emparer de l’âme tout entière, l’éblouir, l’écraser sous d’irrésistibles impressions. On en a pour des jours avant de se remettre et de reprendre possession de soi-même. Je ne suis pas encore assez maître de moi et de mes sentiments pour en jouir. Ces ruines m’accablent, ces catacombes me transportent, ces grandeurs chrétiennes m’exaltent, cette lumière de Rome m’enivre, et Pie IX, que j’ai vu et entendu, me poursuit et me fascine sans m’abandonner un seul instant. J’écrirai plus tard. »
Une année après, il rappela soudainement son serviteur en plein exercice de ses forces et dans l’accomplissement parfait de tous ses devoirs, le 28 décembre 1863. Paqueron disait quelques jours auparavant : « Tenons-nous prêt; c’est peut—être le moment où Dieu va frapper. » Ses derniers mots furent : « Jésusl... Marie ... les voir ! »
Tels sont les mérites les plus apparents de ce vrai chrétien. La Providence l’avait comblé de tous ses dons : âme vaillante, charmant esprit, philosophe profond, moraliste pénétrant, Paqueron a été bien supérieur à sa destinée en ce monde et admirablement préparé à sa destinée en Dieu.
Confiné dans les honneurs obscurs d’un régiment, Paqueron ne fit que traverser Paris, alors que, dans une de ses convulsions révolutionnaires, Paris s’agitant dans le sang et dans la boue, se déshonorait par un meurtre qui était une lâcheté. Maudissant a jamais la grande ville, Paqueron était allé s’enfermer de parti pris dans une petite ville de province. C'est de là qu’il aimait à contempler, de là qu’il montrait à tous la vraie grandeur d’un horizon digne de l’homme, l’horizon chrétien : le ciel où il aspirait.
Paqueron a brillé de toute la gloire du chrétien dans l’obscurité apparente d’une destinée médiocre.[Rapporter à Dieu tous ses sentiments, toutes ses pensées et tous ses actes, c’est le moyen infaillible de supporter la douleur avec résignation, de tirer de son intelligence tous les fruits qu’elle peut produire, de réaliser la plus grande somme de bien dont l’homme soit capable.
MichelT- Date d'inscription : 06/02/2010
 Re: Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron
Re: Les Gloires de la France chrétienne au 19 eme - Frederic Ozanam ( Société St-Vincent de Paul) et le Colonel Paqueron

27 ans après sa fondation, la Société St-Vincent de Paul comptait 2 500 Conférences dans le monde et réunissait 50 000 membres. En 2013, la Société de lutte contre la pauvreté est présente dans 140 pays et le nombre de ses membres est estimé à 800 000.
FRÉDÉRIC OZANAM – PROFESSEUR ET FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL
1. L’élève de l’abbé Noirot. —— Il. L'étudiant à Paris. – III. Son enseignement à la Sorbonne. — IV. L'homme et ses œuvres.

1 - L’ÉLÈVE DE L‘ABBÉ NOIROT
Christianisme et érudition, une science profonde et une foi candide, toutes les finesses de la critique et toutes les richesses de l’imagination au service des vérités chrétiennes, une activité qui courait sans cesse de la bibliothèque de l’Institut à la mansarde du pauvre, une parole qui dominait par la persuasion un auditoire frémissant de jeunes voltairiens et qui calmait les souffrances du malade et les révoltes de l‘indigent, tel est le spectacle offert à notre admiration par la vie d’un homme de génie et de cœur qu’on peut appeler à la fois le rival de Fauriel ou de Villemain et l’émule de saint Vincent-de-Paul.
Frédéric Ozanam naquit, le 23 août 1813, à Milan, où les hasards d’une existence laborieuse et pénible avaient conduit son père qui s’y était fait une situation distinguée comme médecin. Il était originaire d’une famille juive convertie, où les sentiments religieux étaient héréditaires.
Son grand oncle, mathématicien du XVII siècle, disait pour échapper aux querelles théologiques du temps : « Il appartient aux docteurs de Sorbonne de disputer, au Pape de prononcer et au mathématicien d’aller en paradis en ligne perpendiculaire.» Fontenelle n’a pas manqué de recueillir ce trait dans la notice qu’il a écrite sur ce membre de l’Académie des sciences.
Son père, le docteur Jean Ozanam, lui donna jusqu’à sa mort l'exemple d’un généreux dévouement à son devoir et au soulagement des pauvres. Les deux médecins de l’hôpital militaire de Milan ayant succombé dans une épidémie de typhus, il vint s’établir à leur place et seul y soigna trois cents malades jusqu’à la fin. De retour à Lyon, médecin de l’Hôtel—Dieu, il donnait ses soins aux pauvres. Sa dernière visite fut pour eux; c’est à la suite d’une chute dans l’escalier d’un indigent qu’il mourut le 12 mai 1837.


Le Dr Jean Ozanam formait comme une transition entre les générations différentes de sa famille : mathématicien comme son oncle, historien comme son fils, Jean Ozanam fondait ces deux rôles en un, lorsque, en 1829, il écrivait son Mémoire statistique sur l’établissement du christianisme à Lyon.
Jamais un enfant ne fut élevé dans des conditions meilleures, jamais dispositions heureuses et nobles tendances ne fleurirent dans un sol et dans un milieu plus favorable: tous les fruits que peut produire une excellente éducation furent assurés à cet enfant dont l’instruction fut suivie avec la plus intelligente sollicitude par un père qui était un savant actif et profondément catholique, auquel s’associait une mère très intelligente, très lettrée, douée à la fois d’une douceur angélique et d’une inflexible fermeté; aussi fut-elle jusqu’à son dernier jour la plus adorée et la plus obéie de toutes les mères.
Comme nous abusons souvent des meilleures choses, par un engouement banal pour l'action fatale des milieux, on a fait un véritable lieu commun de la peinture des influences maternelles; et cependant pour Ozanam, comme pour saint Augustin, comme pour Marceau, il faut bien signaler le fait en y insistant. De même que les premières leçons de sa mère jetèrent dans son âme les germes du sentiment chrétien, de même, à partir de l‘année 1839 où il la perdit, le souvenir de sa mère fut son guide et son étoile, étoile si fidèle qu’il en était venu à se consoler de sa mort, par ce qu’il appelait « la Conviction de sa présence réelle. »
Ce sentiment de piété filiale était la source d’une délicatesse d’âme à laquelle un de ses disciples et amis rapporte l’horreur toute particulière que lui inspiraient les conversations légères et les libres écrits qui profanent et avilissent l’amour. Il a été récompensé de ce culte pieux, en trouvant la formule à la fois la plus profonde et la plus délicate de la destinée des femmes en ce monde: « Le rôle des femmes chrétiennes ressemble à celui des anges gardiens: elles peuvent conduire le monde en restant invisibles comme eux. »
D’ailleurs, Ozanam a résumé lui-même en des lignes charmantes le tableau des bénédictions accumulées par la bonté de la Providence : « Au milieu d’un siècle de scepticisme, Dieu m’a fait la grâce de naître dans la foi. Enfant, il me prit sur les genoux d'un père chrétien et d’une sainte mère; il me donna pour première institutrice une sœur intelligente, pieuse comme les anges qu’elle est allée rejoindre. Il n’est pas une brise favorable qui n’ait soufflé sur ma tige pour y faire éclore des fleurs; il n’est peut-être pas dans la vigne du Père de famille éternel, un cap qu'il ait entouré de plus de soins. »

L’élégance poétique de ce témoignage sur lui-même n’est pas seulement l’effet de la culture littéraire; un de ses professeurs a laissé de l’écolier du collège de Lyon un portrait qui révèle les qualités précieuses que Dieu lui avait départies: Rien ne souriait autant à son esprit que la poésie. Il trouvait un charme extraordinaire à imiter tous les rythmes dont les poètes de l’antiquité nous ont laissé des exemples. Sensibilité du cœur, vivacité de l’imagination, activité de l’intelligence, finesse et pénétration de l’esprit, mémoire fidèle, bon sens admirable, raison précoce, tout ce que nous admirons dans cet homme d'un si éminent mérite, il le doit à Dieu et à ses parents; il le perfectionna par de solides études littéraires.
Les environs si pittoresques de Lyon offraient au jeune homme des sentiers solitaires et escarpés où il aimait à Promener avec ses excellents maîtres des rêveries toujours pieuses et élevées. Dès le collège, une philosophie spiritualiste lui faisant voir l’homme tel que la foi le lui révélait déjà, vint affermir son intelligence et son cœur : il sentit comment l’accord fécond de la révélation avec le raisonnement fait du chrétien un sage et préserve le sage de la suffisance et de l'orgueil.
En effet, à ces premières études philosophiques d’Ozanam, se rattache le souvenir d’un professeur aussi éminent en logique et en méthode qu'en simplicité modeste. Véritable Socrate chrétien, l’abbé Noirot n‘a rien laissé par écrit; mais pendant vingt ans, sa dialectique féconde a fait germer dans les jeunes âmes toutes les bonnes semences d’une philosophie chrétienne. Ozanam a été le plus illustre, mais non le seul des élèves de l'abbé Noirot qui ont honoré la mémoire de leur excellent maître et qui lui rapportent leur science, leurs vertus et leurs succès. C’était à l’enseignement de l'abbé Noirot que plus tard Ozanam attribuait l’ordre et la lumière qu’il aimait à conserver dans ses pensées et dans sa conduite.
2- L’ÉTUDIANT A PARIS
En 1831, personne encore n’avait songé à faire du travail littéraire un gagne-pain et du journalisme une carrière: la littérature, même sous sa forme la moins élevée, passait encore pour une occupation toute libérale; c’était le luxe de la vie; Ozanam écrivit de très bonne heure. Quelques articles remarqués des habitants de Lyon dans l’Abeille française et le projet de commencer à dix-huit ans un livre intitulé Démonstration de la vérité de la religion chrétienne par l’antiquité des croyances historiques, religieuses et morales n’arrêtèrent point ses parents, qui voulaient faire de leur fils un notaire. A seize ans, il fut envoyé à Paris pour y commencer son droit, seul et a la garde de Dieu.
Cette confiance un peu naïve et fort téméraire ne fut point trompée; l’événement la justifia. En effet, au lieu de se laisser éblouir et enivrer par le tourbillon de la Vie parisienne, au milieu de cette agitation, Ozanam ne fit que sentir avec plus de regret son isolement; il écrivait à sa mère. « Me voilà jeté sans appui, sans point de ralliement dans cette capitale de l’égoïsme, dans ce tourbillon des passions et des erreurs humaines. Qui se met en peine de moi? Je n’ai pour épancher mon âme que vous, ma mère, vous et le bon Dieu... Mais ces deux-là en valent bien d’autres. »
Ainsi son éducation chrétienne avait fait à cette belle âme une atmosphère qui la protégeait contre la contagion du vice et du plaisir. Sa délicatesse morale et sa supériorité d’esprit ne lui permirent pas de subir platement le joug de la capitale. A vingt ans, il écrit ce beau parallèle entre Paris et Lyon : «Paris me déplaît. C’est vraiment le désert moral... Pour moi cette ville sans bornes, où je me trouve perdu, c‘est Cédar, c’est Babylone, c’est le lieu d’exil et de pèlerinage ; et Lyon, c’est ma ville natale, avec ceux que j’y ai laissés, avec la provinciale bonhomie, avec la charité de ses habitants, avec ses autels debout et ses croyances respectées. »
Il écrivait encore à propos du Panthéon qu’il voyait de sa fenêtre : « Singulier monument que ce temple païen au milieu d’une ville chrétienne, avec sa coupole magnifique, veuve de la croix qui la couronnait si bien! Que signifie un tombeau sans croix, sans sépulture, sans pensée religieuse qui y préside? Si la mort n’est qu’un phénomène matériel qui ne laisse après lui aucune espérance, que veulent dire ces honneurs rendus à des os desséchés et à une chair qui tombe en pourriture? Le culte du Panthéon est une véritable comédie comme celui de la Raison et de la Liberté.»
Du reste, son isolement n’était point sauvagerie; car cette tristesse et ces regrets s’alliaient à un ardent désir de s’unir à quelques amis pour travailler et pour faire le bien en commun. Une circonstance fortuite, pourquoi ne pas dire une faveur de la Providence le mit en rapport avec M. A.-M. Ampère qui, séduit par l’analogie de leurs goûts et de leurs sentiments, lui offrit le vivre et le couvert, dirigea ses travaux et prit plaisir à lui exposer ses doctrines philosophiques et religieuses dans des entretiens qui se terminaient souvent par cette simple et sublime exclamation échappée au cœur de cet homme de génie: « Que Dieu est grand, Ozanam, que Dieu est grand! »- Ainsi, avec la naïveté d’un tout petit enfant, ce savant d’un ordre supérieur rapportait à leur cause les merveilles qu’il découvrait mieux que personne dans la nature; plus il était savant, plus il était chrétien!
C’est pendant ces deux années de séjour chez M. A.-M. Ampère que se noua entre Ozanam et le fils de son hôte une amitié cimentée par la sympathie des goûts, la communauté des études et une estime sérieuse et profonde que le temps vint encore affermir, puisque c’est à J .-J . Ampère qu’0zanam dut de reconnaître ses aptitudes supérieures pour l’érudition et pour le professorat.
Il faut enregistrer encore un témoignage de l'influence puissante de l'éducation première et du premier milieu : Combien pourrait—on citer d’exemples dans l'âme d'un jeune homme qui n’a pas vingt ans, d’un sentiment aussi vif, d’une perception aussi nette de qu’il veut? Quelle incroyable maturité dans ce plan de conduite: « Comme avocat, comme homme, j’aurais dans le monde trois missions à remplir; et je devrais être, pour arriver à mon but, jurisconsulte, homme de lettres, homme de société. Ici donc commence mon apprentissage, et la jurisprudence, les sciences morales et quelque connaissance du monde envisagé sous le point de vue chrétien, doivent être l’objet de nos études. Plusieurs moyens nous sont donnés en ce moment par la Providence pour nous essayer dans cette triple carrière : ce sont les conférences de droit, celles d'histoire et les réunions chez M. de Montalembert. Sous l’égide de ces deux hommes éminents la lutte contre les attraits de la vie mondaine devient facile et le triomphe est sûr. »
Personne ne fut moins esclave de la mode, et des entrainements de la jeunesse. Dans la première visite qu’il fit à Chateaubriand, celui-ci lui demanda s’il connaissait quelques-uns des théâtres de Paris. « Non, répondit Ozanam, j’ai promis à ma mère de ne pas mettre le pied dans un théâtre.» Ému de cette réponse pleine de candeur, le vieillard l’embrasse en lui disant: « Eh bien! je vous conjure d’obéir à votre mère. Au théâtre vous ne gagneriez rien et vous pourriez perdre beaucoup. »
Le conseil ne fut pas perdu et plus d‘une fois aux sollicitations de ses jeunes amis, qui voulaient l’entraîner au spectacle, 0zanam ne craignit pas de répondre : « M. de Chateaubriand m’a dit qu’il n'est pas bon d’y aller. »
De cet accueil paternel que Chateaubriand avait fait à sa jeunesse le 1 janvier 1832, il retint le sentiment très vif de ce que les hommes en situation doivent de bienveillance et de soutien aux jeunes gens; et pendant toute sa vie, Ozanam eut soin de mettre une partie de ses matinées à la disposition de tous ceux qui croyaient avoir besoin de ses directions ou de ses encouragements.
A vingt-deux ans, il se faisait un crime d’employer son activité à des travaux intellectuels égoïstes, de se contenter d‘accomplir ses devoirs de piété, sans rien produire que des
œuvres «d’écrivassier», comme il disait: « Les actions valent bien mieux que les paroles !» ajoutait—il.

Rayonner au dehors par l’exemple et par l’association était un besoin pour cette nature généreuse ; il écrivait à deux amis, une lettre qui contient le germe de l’institution des conférences de Saint-Vincent-de-Paul : « Ébranlé quelque temps par le doute, je sentais un besoin invincible de m'attacher de toutes mes forces à la colonne du temple, dût-elle m’écraser dans sa chute; et voilà qu'aujourd’hui, je la retrouve, cette colonne, appuyée sur la science lumineuse des rayons de la sagesse, de la gloire et de la beauté; je la retrouve, je l’embrasse avec enthousiasme, avec amour. Je demeurerai auprès d’elle, et de là, j’étendrai mon bras, je la montrerai comme un phare de délivrance à ceux qui flottent sur la mer de la vie. Heureux si quelques amis viennent se grouper auprès de moi! Alors nous joindrions nos efforts, nous créerions une œuvre ensemble, d’autres se réuniraient à nous, et peut-être, un jour, la société se rassemblerait-elle tout entière sous cette ombre protectrice. Le catholicisme, plein de jeunesse et de force, s’élèverait tout à coup sur le monde, il se mettrait à la tête du siècle renaissant pour le conduire à la civilisation, au bonheur! 0 mes amis! je me sens ému en vous parlant, je suis tout plein de plaisir intellectuel car l’œuvre est magnifique, et je suis jeune et j’ai beaucoup d’espoir! »
La pratique suivant sans retard la théorie, en 1833, par un beau dimanche de juin, Ozanam allait avec une trentaine d’étudiants, se joindre à une procession de la Fête Dieu, à Nanterre, pour y porter l’édification du bon exemple.
A cette époque, sans être aussi brutale qu’en 1880, l’impiété était dans les mœurs et dans l’éducation publique. L’hostilité contre le culte et contre les prêtres s’appuyait sur un mépris raisonné de l’Évangile; on n’osait pas encore lui substituer le règne des appétits inférieurs de la nature humaine : c’était, croyait-on, par amour de la liberté qu’on prescrivait l’autorité divine, il restait quelque chose d’humain et d’intelligent jusque dans l’impiété.
Se croyant soutenue par la raison, l’irréligion devenait une sorte de secte passionnée qui usait avec succès de toutes les armes de l’esprit, de la logique et de la poésie: elle était l’inspiration de la politique, des journaux, des conversations du monde, de l’éducation officielle de la jeunesse : l’instruction religieuse n’était plus guère qu’un mot sur les programmes de l’Université.
Aujourd’hui que la religion est bannie et persécutés, la soutenir et la défendre est une œuvre qui répond au peu qui nous reste encore de français et de chevaleresque au fond de l’âme; à l’époque d’Ozanam, la résistance au flot révolutionnaire de l’impiété réclamait plus de courage et avait plus de mérite. Ozanam devine et employa avec un succès admirable la tactique la plus sûre pour attaquer le mal : il s’unit à quelques amis de son âge et presque tous de son pays et, suivant avec assiduité les cours de la Sorbonne, il relevait toutes les attaques contre le catholicisme et ensuite il adressait au professeur une réclamation respectueuse et raisonnée, pour l’adjurer de réparer par une correction le mal que son enseignement avait pu produire dans des âmes jeunes, dociles et avides de savoir.
Le moyen était audacieux; mais il était efficace pour prouver à la jeunesse des Écoles qu’on peut être catholique et avoir le sens commun; qu’on peut aimer à la fois Dieu et la liberté. Le triomphe de cette campagne fut d’amener Jouffroy à lire en pleine Sorbonne une protestation catholique, à témoigner pour les convictions religieuses dont elle était l‘interprète une sincère vénération et à signaler comme un progrès, que «le spiritualisme qui, en 1825, ne rencontrait que des objections matérialistes, avait maintenant en face de lui une opposition toute catholique. »
C’était un jeune étudiant de vingt ans à peine qui venait de lever cet étendard et de remporter cette victoire. Ainsi, valeureux champion de la foi chrétienne, il acceptait le combat sur le terrain où l’ennemi l’avait porté. C’est à l’histoire et à la conscience qu’il voulait s'adresser comme a Jouffroy, pour leur demander d’être les témoins du christianisme et de montrer combien il est faux de dire que « ces dogmes finissent, » puéril et mesquin aveuglement de l’esprit voltairien tombé en enfance, dont Jouffroy, lui-même, s’est cruellement repenti, puisque moins de dix ans après, l’orgueilleux prophète du Globe se mettait lui-même à l’école du petit catéchisme. Ozanam ressentait une pieuse tristesse en assistant à ces funestes prédications. Il prévoyait bien que les générations corrompues par un tel enseignement ne seraient capables ni de se gouverner elles-mêmes, ni de lutter contre l’émeute et l'assassinat qui ont attristé dix années du règne de Louis-Philippe, ni de se protéger enfin contre le triomphe du désordre et de la révolution au 24 février 1848.
Par un mouvement sûr et loyal de sa foi catholique Ozanam tourna fièrement l’écueil contre lequel vinrent se heurter plusieurs de ses plus éminents contemporains. Sa lucidité de jugement fortifiée par la doctrine chrétienne lui fit deviner le péril des mirages trompeurs du saint-simonisme, et il publia sur ce sujet une brochure qui lui valut les félicitations de Lamartine. « Ozanam, dit J.-J. Ampère, opposait à cette doctrine antichrétienne et nouvelle à la fois l’Évangile et l’antiquité, cherchant dès lors, d’une main novice encore, mais d’une main déjà résolue, à saisir l’enchaînement des traditions du genre humain. »
C’était comme la préface du livre auquel il devait travailler jusqu’à son dernier jour et dont le projet avait été une de ses premières conceptions de jeunesse. Les impuissants novateurs du saint-simonisme se donnaient pour les héritiers directs du christianisme : ils reléguaient l’Église dans l'ossuaire du passé et prophétisaient un avenir de progrès indéfini à leur doctrine qui a devancé ses fondateurs dans la tombe et le néant.
De même que Marceau, que La Moricière, qu’Augustin Thierry, que Michel Chevalier et tant d’autres, Ozanam entendit les prédications de ces bruyants apôtres d'une religion sans Dieu, qui, comptant sur l’infaillibilité de la raison et surtout de leur raison, promettaient aux hommes d'établir par la science et par une discipline nouvelle le règne indéfini du bien-être, réhabilitant le plaisir et proposant une organisation pacifique de toutes les passions.
Méthode bien simple, pour n’avoir point à combattre le mal, ils niaient le mal; et le mal les a si bien envahis que l’ordre social fut obligé de les extirper comme une lèpre mortelle. Ozanam n’eut pas besoin de recourir à cet expédient héroïque. Loin de nier le mal, il voulut le combattre et le combattit par les armes que lui offrait la charité chrétienne.
L’établissement de cette conférence des « huit » qui est devenu le germe de l’œuvre des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul était la plus éloquente réponse aux déclamations vides et funestes des saint-simoniens. On réclamait des institutions pratiques servant à relever la condition abjecte des pauvres; quoi de plus pratique que ces visites des huit associés aux indigents de leur quartier pour leur porter le soulagement de toutes les misères, le remède aux maux de l’âme et du corps, la divine charité des enfants de Jésus-Christ! Admirable création qui était le salut des bienfaiteurs non moins que de leurs obligés.
Après avoir été unis et confondus dans les ténèbres salutaires des catacombes, l’Église et le monde se sont de plus en plus séparés, l’Église a formé dans la société du moyen-âge une aristocratie politique, dominant et excluant presque les laïques. Dieu ne veut pas de ces distinctions Orgueilleuses parmi les serviteurs des serviteurs de Dieu. Sans rien briser et tout en respectant une supériorité morale que le sacrifice rend digne de tout respect, l’Église a admis les laïques à se rapprocher des prêtres; elle leur a permis d’offrir aux religieux le concours de leur charité, pour le bien du corps et de l’âme.
Une des innovations heureuses, un des progrès du temps présent dans les choses de la religion, c’est l’initiative que prennent maintenant les laïques dans les œuvres de charité. Peut-être ce zèle n’a-t-il pas toujours rencontré tous les encouragements dont il est digne; mais ce sera encore un de ses mérites de vaincre les défiances par une persévérance pleine de douceur et de ménagements : quand on sait qu’on a Dieu avec soi, on se sent si fort, qu’on peut bien être patient.

La pauvreté ouvrière au 19 eme siècle
Un soir du mois de mai 1833, huit étudiants dont le plus âgé n’avait pas vingt ans, se rendirent chez M. Bailly, directeur de la Tribune catholique, pour le consulter sur la réalisation d’un projet dès longtemps conçu par Ozanam et qui consistait à former une société de charité procédant non plus par des discussions, mais par des œuvres. Éclairé par son expérience et par son cœur, M. Bailly comprit que cette institution serait le salut d’un grand nombre de familles pauvres et la sauvegarde des jeunes fondateurs qu’elle protégerait contre le vice et maintiendrait dans l'honneur et dans la vertu, il applaudit à. ce projet, offrit pour siège de la société le bureau de son journal et accepta d’être le président de l’œuvre nouvelle.
Ozanam et ses amis venaient de fonder la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, qui depuis s’est étendue et multipliée sur toute la surface du globe. Un éminent évêque, Mgr Parisis, a dès lors caractérisé en termes excellents l’œuvre nouvelle et pressenti son succès: « Je crois que les catholiques ont pour les temps présents une mission particulière et providentielle. Partout le monde se sécularise. Aussi les hommes du jour se plaisent-ils à répéter que l’État est laïque. Eh! bien, Dieu leur a répondu : Je susciterai au milieu de vous un sacerdoce laïque qui n’aura ni le caractère sacramentel que vous blasphémez, ni l'habit austère que vous redoutez, ni la vie tout à fait à part que vous critiquez; mais qui aura l’intelligence et le zèle du sacerdoce véritable ; qui en fera non pas les fonctions sacrées, lesquelles resteront toujours dans les limites de la hiérarchie ecclésiastique, mais les fonctions sociales. Voilà l’action de la divine Providence dans les temps modernes; œuvre de Saint-Vincent-de-Paul, de Saint-François-Régis, de Saint-Joseph, œuvre de l’Océanie. »
Apôtre laïque du christianisme, Ozanam étendait son action et la portait sur tous les points où le danger venait se manifester. En 1834, répondant aux vociférations impies de quelques étudiants belges par une protestation en faveur de l’Université catholique de Louvain, il stigmatisait en termes qui sont toujours exacts les ennemis de la religion: « Ils ne sont ni les champions de la liberté, ni ceux de la science.» Avec une persévérance que des promesses formelles autorisaient pendant deux années de suite, Ozanam et ses amis présentèrent à l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen, une pétition couverte de signatures, qui demandait l’établissement de conférences pour la jeunesse catholique à Notre-Dame; et, pour traiter ces questions passionnément discutées des rapports de la religion et de la société moderne, ils proposèrent un jeune prêtre que la rédaction du journal l'Avenir et le procès retentissant de l’École libre avaient recommandé aux vives sympathies de la jeunesse.
Leurs vœux ne furent exaucés que le 8 mars 1835. Comme l’œuvre du bien est laborieuse, pénible et lente dans notre société! Il fallut sept années de prédication assidue par l’abbé Lacordaire, puis par le P. Ravignan, pour que l’œuvre des conférences de Notre-Dame eût son couronnement naturel dans la communion pascale des hommes, à la fin du carême de 1842 : le mal est bien plus vite fait qu’il n’est réparé et l’incendie s'allume plus rapidement qu’il ne s’éteint.
Toutefois c’est un nouveau titre d’Ozanam à. la reconnaissance de la France chrétienne que d’avoir travaillé à. lui donner son plus éminent propagateur : Lacordaire avait trente et un ans, Ozanam en avait vingt et il accourait auprès du jeune prêtre pour susciter dans l’éloquent avocat de 1830 le défenseur qu’il croyait nécessaire de donner à la religion devant la France de 1833.
Ainsi toujours attentif au plus grand bien de son ardent serviteur, Dieu préparait a Ozanam de nouveaux auxiliaires quand ses appuis naturels allaient lui manquer. Malgré ces prévenances de la sollicitude divine, Ozanam ressentit une grande douleur et un accablement profond, lorsqu’en 1839 il perdit sa mère; il exprimait ainsi son inexprimable regret : « Elle me semblait la plus parfaite expression de la Providence. Aussi je crois me sentir à peu près comme les disciples devaient être après l’ascension du Sauveur : je suis comme si la Divinité s’était retirée d’auprès de moi. » D’ailleurs, en digne fils de celle qui pour lui représentait Dieu lui-même; il était capable de se guider lui-même sur la route où il avait été engagé. Cependant, malgré tant de saintes choses accomplies, il n’avait pas encore trouvé la tribune du haut de laquelle Dieu voulait qu’il fit entendre sa parole féconde.
Mais déjà, à l’âge de vingt-sept ans, quel noble et vivifiant spectacle présentait à la jeunesse française une raison éclairée par l’étude et purifiée par la foi de toute souillure de vanité! Jamais les témoins les plus défiants n’ont pu surprendre dans sa physionomie, son attitude et son langage rien qui ressemblât à de la suffisance ou de la hauteur; privilège d’une âme qui ayant toujours Dieu présent a toujours le sentiment de son humilité personnelle.
3 - SON ENSEIGNEMENT A LA SORBONNE
Quoiqu’il fût bien jeune encore, il avait fait tant de choses et déployé de si grandes qualités d’esprit et de cœur qu’on s’étonne presque de ne point le voir, après dix ans passés à Paris, engagé dans la carrière où il doit s’immortaliser. Son respect pour les volontés de son père et sa déférence pour sa mère l’avaient maintenu dans l’étude du droit; il était docteur depuis 1836 et la ville de Lyon avait en soin de s’assurer les services de cet éminent esprit, en lui donnant en 1839 une chaire de Droit à la Faculté.
Obéissant aux tendances naturelles de son esprit généralisateur, Ozanam communiquait un caractère philosophique à toutes ses études; par suite de son goût passionné pour
l'érudition, il recherchait le côté historique de toutes les questions. Aussi, même dans un cours de droit commercial il provoqua l’intérêt persévérant d’un nombreux auditoire
par l’élévation de ses principes et par l’exactitude de ses rapprochements historiques.
Mais il fallait un plus vaste horizon à la puissante envergure de sa science et de sa parole. Plus d’une fois la pensée lui vint de se consacrer tout entier au service de Dieu et il attendait avec un sincère désir que Dieu même lui fit signe qu’il l’agréait dans sa sainte milice, pour se joindre à Lacordaire dans l’ordre même des Frères prêcheurs, où les espérances de son ami l’appelaient déjà cordialement. C’est sans doute au souvenir des saintes aspirations de sa jeunesse qu'Ozanam fit allusion un jour que, aux adieux d’un de ses anciens élèves, devenu son ami, qui allait entrer dans un ordre naissant, il répondit dans un étroit embrassement : « Vous êtes plus heureux que moi : allez en confiance »
Mais l’ordre supérieur ne vint pas et des voix amies s’unissaient à celles de J.-J. Ampère pour retenir le jeune professeur dans le monde que ses vertus honoraient. Oui, c’était du camp même de l'histoire, de la science, de la poésie et de l’éloquence que Dieu voulait tirer un nouvel avocat de la religion; la mission d’Ozanam était de réconcilier la Sorbonne révolutionnaire avec l’ordre et l’autorité de l'Église.
En dépit de son culte respectueux pour les défenseurs du passé tels que de Bonald et de Maistre, Ozanam ne croyait pas que pour guider la nation, il fallût marcher dans le sens contraire au courant qui emportait le public; ces apologistes du passé lui semblaient condamnés au sort de Cassandre pendant le siège de Troie. Vivement sollicité par Victor Cousin, alors ministre de l’Instruction publique, qui l’avait distingué et qui par lui voulait donner un grand éclat à une création nouvelle, l’agrégation des facultés, Ozanam vint à Paris, prit part au concours et obtint de haute lutte le premier rang sur des concurrents dignes de se mesurer à lui. D’abord suppléant, puis successeur de Fauriel, il commença en 1840 un cours d’histoire des littératures étrangères où, dès le premier jour, il enleva l’admiration de ses auditeurs.
Son heureux apostolat dans l’enseignement public de la Sorbonne dura douze années, douze années de succès et d'applaudissements chaque jour plus nombreux et plus convaincus. Si sévère que soit le goût moral pour les caprices de la popularité, quelque dédain que les aristocrates de la pensée affectent pour les bravos de la foule, il faut bien reconnaître que le public est rarement insensible à la sincérité des convictions et à la persévérance du désintéressement. C’est ainsi qu’on peut expliquer comment Ozanam a conservé douze ans une popularité qui n’avait été achetée par aucune concession aux erreurs et aux passions du temps. A cette sincérité, il joignait une bonté qui gagnait et retenait toutes les sympathies et sans laquelle l’édifice de son succès eût pu être caduc et passager : la loyauté inspire le respect et prépare l'autorité; la bonté gagne les cœurs et consolide la victoire.
Ce triomphe d’un avocat de Dieu et du catholicisme à la Sorbonne était un véritable miracle moral, tant la jeunesse était alors séduite et agitée par l’enseignement rival de deux professeurs qui, avec des mérites bien différents, tirant leur force tout autant de leurs graves défauts que de leurs puissantes qualités, ne craignaient pas de se faire les fauteurs de l’esprit révolutionnaire et préparaient au nom de la liberté le plus lourd et le plus brutal des despotismes: le despotisme du nombre.
Pour lutter contre les violences des ennemis de la religion qui, parfois, au Collège de France ou à la Sorbonne, étouffaient la voix des professeurs par le tumulte et rendaient tout enseignement impossible, Ozanam et ses amis fondèrent, sous le nom d'Institut catholique, un système de conférences littéraires et scientifiques où toutes les questions du jour seraient traitées sérieusement devant un auditoire attentif et respectueux.
Les travaux d’Ozanam furent, avec ceux du baron Cauchy, le plus vif intérêt de cet enseignement, qui se continue aujourd'hui par le Cercle catholique du Luxembourg. C’est donc encore à Ozanam que les familles chrétiennes doivent la sécurité d’offrir à leurs fils, en 1886, un asile studieux, une société pieuse, de sages conseils et de nobles leçons. Pour répondre aux désirs de quelques âmes avides d’instruction religieuse, furent fondées les conférences philosophiques de l’abbé Gerbet, et les leçons d’économie politique par M. de Coux. Ces deux maîtres, avec un grand sens de la vérité pratique, sondaient la plaie de notre société démocratique et signalaient le remède qui seul peut la guérir. Ainsi voilà un fait moral considérable et dont il ne faut pas dissimuler la gravité; depuis plus de cinquante années, des esprits éclairés et des voix prophétiques disent au peuple, du haut de la chaire et du haut de la tribune, la vérité que le peuple ne veut pas entendre. L’expérience douloureuse de ce demi-siècle où la France a tant perdu, cette expérience aura-t-elle enfin profité à notre éducation morale?
Jamais Ozanam ne négligea une occasion d’enseignement chrétien et de propagande religieuse; en 1848, il annonça comme sujet de son cours l’Histoire des républiques italiennes au moyen-âge, voulant montrer par les faits combien l’esprit chrétien est fécond et puissant pour la gloire et la prospérité des républiques. Forcé par le malheur des temps de prendre part aux luttes fratricides de 1848 et poussé en avant par les obligations et les espérances de la charité chrétienne, ce fut lui qui, le 25 juin 1848, eut avec M. Bailly et M. Cornudet la mission de conduire de l’île Saint-Louis jusqu’au palais de l’Assemblée nationale, à travers une multitude armée, Mgr Affre allant demander au général Cavaignac, président de la République, une promesse de pardon pour les insurgés, s’ils mettaient bas les armes. Ozanam voulait même accompagner au faubourg Saint-Antoine l’archevêque qui marchait au martyre.
Ce même sentiment de prosélytisme chrétien l’animait partout et lui inspirait une sincérité d’action et de parole qui le préserva de bien des périls. Une des plus graves difficultés que lui suscita sa situation universitaire à partir de 1850 fut l’antagonisme passionné entre l’Université et la société catholique, au sujet de la liberté de l’enseignement. Ozanam ne pouvait ni méconnaître ses devoirs de gratitude envers la Faculté des lettres qui l'avait distingué, accueilli, honoré; ni manquer à ses convictions de catholique et d’ami de la liberté. Il remplit ses devoirs de professeur à la Sorbonne avec un zèle si consciencieux, et il suivit le mouvement des réunions catholiques et libérales avec une franchise si loyale, qu’il conserva l’estime des deux partis, fut maintenu dans sa chaire et confirmé dans son succès.
Pour cela, il n'eut qu’à s’abandonner au penchant de sa nature vers le bien et le devoir prêt à tous les sacrifices et les yeux toujours fixés sur le but, n’ayant besoin d’aucun effort pour éviter les écueils de la route. Sans dissimuler aucune de ses opinions de libéral et de catholique, il se renferme dans le cercle étroit de son enseignement universitaire, évitant avec soin de transformer sa chaire de Sorbonne en une tribune politique. Il avait trouvé son véritable rôle : professeur de morale chrétienne, mettant au service de son enseignement l’érudition et l’histoire, les beaux-arts et la poésie. Il résumait tout son passé lorsque, au printemps de 1852, dans une magnifique improvisation qui fut sa dernière leçon à la Sorbonne, grelottant la fièvre, il disait à ses auditeurs : « Notre vie vous appartient; nous vous la devons jusqu'à notre dernier souffle, et vous l’aurez. »
Depuis l’été de 1846, c’est-à-dire depuis l’âge de trente trois ans, Ozanam sentait ses forces décroître à mesure que grandissaient son influence et sa renommée. Suppléant par l’effort de la volonté à sa santé qui chaque jour déclinait, déjà il était atteint de ce tremblement nerveux des mains qui est le précurseur d’une caducité précoce. Perdus pour l’enseignement, les derniers mois de sa vie furent encore productifs pour l’œuvre de charité à laquelle son nom reste pour toujours attaché. Il écrivit de Pise en 1853: « Nous avons des Conférences à Québec, à Mexico et à Jérusalem. Comment n'aurions nous pas une Conférence à Sienne qu’on appelait l’antichambre du paradis?»

Ainsi ses derniers efforts furent consacrés à étendre en Italie les Conférences qu’il avait fondées vingt ans plus tôt. Le 8 septembre 1853, sur les brillants rivages de Marseille, dans cet éclat de la lumière du Midi, au sein de cette douce chaleur, parmi toutes ces splendeurs poétiques dont il avait le culte intelligent et passionné, il s’endormit dans la mort, au pied de la colline de Notre-Dame-de-la-Garde.
Il venait d’atteindre sa quarantième année et mourait au début de sa maturité, comme Raphaël, comme Mozart dont il avait la suavité poétique, comme Pascal dont il partageait l’ardente curiosité, l’humilité devant Dieu, l’aspiration passionnée à l’infini et au parfait; qu’il surpassait par sa foi et sa charité. Son testament est tout entier dans ces mots d’une ferme adhésion à la croyance de toute sa vie: «J’ai connu les doutes du siècle présent; mais toute ma vie m’a convaincu qu’il n’y a de repos pour l‘esprit et le cœur que dans la foi de l’Église et sous son autorité...Par la religion seule j’ai trouvé la lumière et la paix. »
Son dernier mot est un dernier acte de foi d’espérance et de charité. Au prêtre qui lui disait d’avoir confiance en Dieu: « Pourquoi le craindrais-je, répondit-il, je l’aime tant!»
Son angélique charité le consolait de mourir avant le temps; il espérait que « ses souffrances et sa soumission à la volonté de Dieu profiteraient mieux que sa vie et ses travaux prolongés à ceux qu’il aimait et que son cœur saignait d’abandonner sitôt.»
L’HOMME ET SES OEUVRES
Si vous comptez la somme des années, combien cette existence paraît courte; si vous considérez le nombre et la valeur des œuvres, comme ces années sont bien remplies
et avec cette féconde unité que seule peut donner la foi catholique!
La vie d’0zanam a été bien caractérisée par le mot d’un ami: « Ce fut l’apostolat d’un prêtre dans l’existence d’un laïque. Le penseur était passionné pour l’étude et possédé d’une ardente curiosité de savoir; le chrétien avait tout le zèle de l’apostolat dans la foi, l'espérance et la charité. A tous ses jugements, à toutes ses émotions il donnait pour principe et pour fin la pensée de Dieu. C’était une démonstration de l’existence de Dieu par les merveilles de la nature que lui suggérait la vue du cirque de Gavarnie et à sa description il donnait cette conclusion pratique : « S’il restait encore des athées, c’est ici que je voudrais les amener pour les voir tomber à genoux, terrassés et ravis.» Glorifier le christianisme par ses œuvres, telle fut la pensée morale qui domina toutes ses études historiques et qui devait être l’âme de son histoire littéraire du moyen-âge depuis le v° siècle jusqu’à la fin du XIII° siècle.
Ni l’autorité n’a manqué à sa science, ni le respect de tous à sa loyauté. La sincérité généreuse de ses convictions, de son attitude et de son langage lui concilie tous les cœurs. Catholique au sein de la Sorbonne libérale et presque révolutionnaire, libéral dans le cercle de ses amis, tous fervents catholiques, il conserve sans nulle atteinte l’estime du corps dont il était membre, l'affection de ses amis et la sympathie de cette foule mobile et flottante qui fait l’opinion, le crédit et la gloire. Succès bien honorable, car malgré sa douceur, jamais ses concessions n’allèrent jus qu'au déguisement de sa pensée; et Lacordaire a pu dire: « Si le respect des âmes lui inspirait une exquise modération, le respect de son âme l'élevait au-dessus de toute crainte humaine.»
Ardent et sérieux ami de l’humanité, sympathique à toutes les misères, toujours prêt à se dévouer pour les soulager, il avait reçu de Dieu une âme expansive qui devait briser avant le temps sa frêle enveloppe : « Je n’ai jamais travaillé pour la louange des hommes ; mais pour le service de la vérité. »
Souffrant des misères de notre temps révolutionnaire, sa charité en cherchait le remède; éclairé par l’histoire, par la raison et par la foi sur la fécondité de la doctrine chrétienne, c’est dans le christianisme qu’il plaçait l’espérance du salut de la France : partout il se faisait un devoir de le dire et de le montrer : tout lui était occasion d’enseignement moral et religieux. Ce fut l’unité suprême de sa vie.
Sans doute, M. Bailly a été le fondateur, le modérateur et le père de la société des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul; mais la pensée en est due à Ozanam et la première application à la touchante société des huit étudiants de 1833. Avec un goût, une délicatesse et un à-propos parfait, Ozanam appliquait à l’œuvre charitable de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul la parabole populaire du bon Samaritain: « L’humanité de nos jours me semble comparable au voyageur dont parle l’Évangile: elle aussi, elle a été assaillie par les larrons de la pensée, par des malfaiteurs, qui lui ont ravi le trésor de la foi et de l’amour; et ils l’ont laissée nue et gémissante, courbée au bord du sentier. Les prêtres et les lévites ont passé, et, comme ils étaient des prêtres et des lévites véritables, ils se sont approchés de cet être souffrant et ils ont voulu le guérir. Mais, dans son délire, il les a méconnus et repoussés. A notre tour, faibles Samaritains, profanes et gens de peu de foi que nous sommes, osons cependant aborder ce grand malade. Peut-être ne s’offusquera-t-il point de nous; essayons de sonder ses plaies et d’y verser de l’huile; et puis nous le remettrons entre les mains de ceux que Dieu a constitués les gardiens des âmes. »

Aux devoirs de la charité chrétienne il subordonnait toutes choses: en 1851, dans un voyage à Londres, tandis que ses compagnons redoublaient leurs visites à l’Exposition universelle du Palais de cristal, Ozanam allait visiter les sous-sol habités par les pauvres Irlandais . « Il en revenait tout ému et un peu plus pauvre qu’en y descendant. »
Loin de se prévaloir des dons d’esprit et de cœur qu’il avait reçus de la Providence, il se reprochait de ne pas tirer de ces instruments qui lui avaient été donnés tout le bien que le service de Dieu a droit d’en attendre et d’en réclamer. Lorsqu’au succès éclatant l’eut appelé à la suppléance de M. Fauriel à la Sorbonne, ce ne fut pas avec une satisfaction légitime et une confiance naturelle qu’il accepta cet honneur, défiant de lui-même il eut besoin des instances amicales de J .-J . Ampère pour renoncer à la modeste sécurité de sa chaire de droit commercial à Lyon.
Les termes dans lesquels il s’en exprime contiennent une éloquente leçon de modestie chrétienne: « En voilà plus qu’il ne faut, écrivait-il, pour effrayer un esprit de médiocre énergie. Heureux, ajoutait-il, si ce sentiment de faiblesse me fait lever les yeux vers Celui qui donne la force: jusqu’ici je lui ai demandé la lumière pour connaître sa volonté; maintenant qu’il semble me l’avoir manifestée par des signes raisonnablement reconnaissables, il reste à m’accorder le courage de l’accomplir..»
Même dans le ravissement d’un amour profond et légitime, de la même plume qu’il écrit comme ferait Alfred de Musset: « Le bonheur dans le présent c’est l’éternité, » il ajoute comme un saint François de Sales: « Aidez-moi à être bon et reconnaissant; chaque jour, en me découvrant de nouveaux trésors dans celle que je possède, augmente ma dette envers la Providence.»
Une des perfections de cette âme exquise c’est d’avoir été le modèle du véritable ami. Il a porté au suprême degré toutes les qualités de sympathie, d’indulgence, d'expansion, de sincérité qui font de l’amitié un des charmes et des secours du voyage de l’homme sur cette terre. Son cœur large et affectueux savait ménager et conserver la part des amis de sa jeunesse, tout en accueillant des amis nouveaux attirés à lui par la séduction des trésors de poésie et de charité brillant au grand jour de son enseignement, de ses écrits, de sa conversation journalière.
Jamais personne n’a mieux rempli la variété des devoirs incessants de l’amitié: félicitations ou redressement, espérance ou consolation, encouragement au bien, arrêt sur une pente funeste. Ses qualités d’esprit sont autant que possible au niveau des vertus de son cœur. Un goût vif pour l’exactitude de l’érudition puisée aux sources, pour l’étendue et pour la variété des informations; de la chaleur, de l’élan; avec une conviction très arrêtée sur les choses, une grande modération à l’égard des personnes. Voilà le portrait littéraire que fait de lui un éminent critique. Grâce à la souplesse de sa nature, une de ses plus précieuses originalités c’était l’union très rare de solidité virile et de juvénile enthousiasme; l’alliance si rare de l'érudition avec l’éloquence et la poésie; l’une en lui était aussi naturelle que l’autre, aussi éminente.
On a exprimé par une charmante image l’originalité de ce rare génie où « la poésie se mêle à la science comme le liseron au blé mur. » Poète non moins qu’érudit, il sentait avec amour l’intérêt des grands tableaux de la nature, soit telle que Dieu l’a faite, soit ornée des monuments de l’art humain. Aussi les voyages occupèrent une place importante dans la vie d’0zanam, c‘était une source d’érudition, de sentiments et d’images où il puisa largement. C’était un artiste en même temps qu’un érudit celui qui, poursuivant l’idéal par la pensée et par le cœur, s‘est efforcé d’en réaliser la perfection par ses discours, ses écrits et ses actes; car il a été orateur, écrivain et fondateur d’œuvres, à la façon de son maître et patron Vincent de Paul.
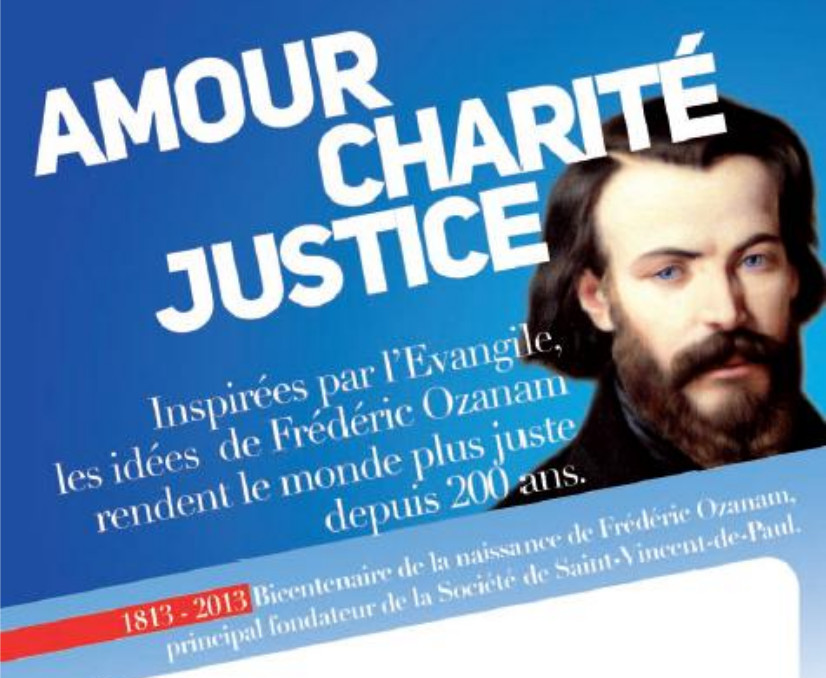
A vingt ans, en 1833, il eut pour récompense de son travail un premier voyage en Italie avec sa famille. Il écrivait au retour à propos de Milan, de Florence, de Lorette et de Rome: « Tous ces lieux ont gardé quelque chose de moi-même et toutes les fois que j'y songe, il me semble que je dois y retourner prendre quelque chose qui y est resté. »
Il l'avait l’imagination du coeur développée jusqu’à une sorte d’hallucination. Après la mort de sa mère, son immense douleur fut calmée par ce qu'il appelait « la conviction de sa présence réelle, » il la voyait, il sentait son inspiration bienfaisante, il recevait avec gratitude les caresses par lesquelles sa mère récompensait comme au temps de son enfance ses efforts, ses travaux et ses succès. Son enseignement a été très bien caractérisé par ce mot de son ami J .-J . Ampère: « Il préparait ses leçons comme un bénédictin et les prononçait comme un orateur. En effet, une physionomie très douce et une parole inspirée attiraient et retenaient la sympathie; on ne se décidait pas à se passer de lui, quand une fois on l’avait connu.»
Il n’eut jamais ni la beauté, ni l'éclat de la jeunesse : d’une pâleur maladive, la tête forte, les traits irréguliers, il portait sur un front large et puissant une épaisse et longue chevelure noire un peu sauvage; malgré la vivacité du regard, sa large face blafarde avait une touchante expression de douceur et de mélancolie: sa voix était à la fois musicale et grave, d’une onction pénétrante : il était impossible de le voir et de l'entendre sans en conserver une impression durable : ce n’était pas du tout le premier venu; il avait le charme et provoquait l’affection.
Encore un trait bien personnel: malgré la puissance de son esprit, ce n’était pas l'orateur, maître de lui-même et de son auditoire comme de son sujet, imposant l’attention ou la sympathie par la sécurité de son attitude et la sonorité de sa voix ; ce n’était pas l’oracle, impérieux interprète du Dieu qui le possède. C’était plutôt, comme la pythie de Delphes, une victime portée malgré elle sur le trépied où elle doit subir la torture de l'ivresse prophétique.
Son éloquence était bien le reflet de cette âme sublime de grandeur et de modestie. La réserve de son attitude préparait l’auditoire à sa phrase hésitante et laborieuse; la voix était sourde, étouffée, balbutiante; le geste embarrassé; le regard mal assuré, comme ébloui, fuyant la lumière ou craignant de rencontrer un autre regard; les contractions même du visage trahissaient une lutte pénible. Puis, peu à peu, le calme se faisait sur sa physionomie, la tête se relevait, le regard était illuminé, la voix retentissait sonore et vibrante, le front puissant secouait et dissipait tous les nuages: Deux, ecce Deus; et de la bouche souriante les mots éloquents, inspirés, roulaient à flots abondants, harmonieux, pressés, mais majestueux; le style était magnifique sans cesser d’être naturel: poésie, science, philosophie, religion, l’horizon s’étendait à l’infini. Un habile cavalier contient d’abord sa monture, se défie de son ardeur et tient à lui faire sentir son autorité; mais quand il s‘est assuré de lui-même et de son cheval, il rend la main, abandonne les rênes et accorde libre carrière à l’impétuosité du coursier à la fois ardent et docile : ainsi faisait Ozanam pour l’émotion oratoire, qui passait de son âme à l’âme de ses auditeurs.
Arraché à son œuvre par une mort prématurée, Ozanam a laissé bien des œuvres différentes par le caractère, le sujet, la perfection, mais toutes semblables par l’esprit qui les anime. Celui qui parcourt d’un regard attendri cet ensemble d’études, de notices, de dissertations, éprouve, suivant l’expression de J .-J . Ampère, « l’émotion que ressentirait un
artiste visitant l’atelier d’un sculpteur mort en plein travail et qui aurait laissé beaucoup d’ouvrages amenés à un inégal degré de perfection : il y a là des statues terminées et polies; il en est qui ne sont qu’ébauchées ou dégrossies à peine; mais toutes portent l’empreinte de la même âme et de la même main. »
Ajoutons une âme toute inspirée de poésie et de religion, une main d’une infatigable activité et d’une délicatesse infinie. Quel serviteur Dieu et la France venaient de perdre.
Fin
MichelT- Date d'inscription : 06/02/2010
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 Portail
Portail